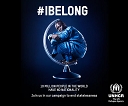- Taille du texte
 |
|  |
|  |
| 
- English
Q&R: La campagne contre l'apatridie gagne du terrain
Articles d'actualité, 12 septembre 2013
GENÈVE, 12 septembre (HCR) – Il y a au moins 10 millions de personnes apatrides dans le monde. On observe une préoccupation grandissante à travers le monde sur leur situation et, parallèlement, un engagement croissant pour soulager leurs souffrances. Depuis que le HCR a lancé une campagne en 2010 pour accroître la sensibilisation sur les apatrides ainsi que le soutien aux deux conventions des Nations Unies relatives à l'apatridie, de nombreux pays ont adopté des mesures pour améliorer la situation en adhérant à l'une ou aux deux conventions. En juillet, la Lituanie a adhéré à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, ce qui sert d'exemple pour d'autres États membres de l'UE et les anciennes républiques soviétiques. C'était également la période où la Lituanie a pris en charge la présidence semestrielle de l'UE, ce qui rajoute encore à l'impact. Le HCR s'est félicité de ce nouveau développement. L'agence pour les réfugiés a reçu le mandat de l'ONU pour prévenir et éliminer l'apatridie à travers le monde ainsi que pour protéger les droits des apatrides. Les efforts de la Lituanie pour prévenir et éliminer l'apatridie depuis la fin du régime soviétique en 1991 sont impressionnants. Seulement 4 000 personnes apatrides environ se trouvent dans ce pays contre près de 400 000 dans les deux autres ex-républiques baltes soviétiques, l'Estonie et la Lettonie. Mark Manly, le chef de l'Unité du HCR chargée de l'apatridie, a récemment discuté du problème de l'apatridie avec Daniel MacIsaac, Chargé de communication au HCR.
Parlez-nous des tendances mondiales actuelles en matière d'apatridie
L'ampleur du problème a varié ces dernières décennies. Les populations apatrides massives du début des années 1990 ont été progressivement réduites, car les nouveaux Etats de l'ancienne Union soviétique ont accordé la citoyenneté à des centaines de milliers de personnes. Les chiffres ont de nouveau augmenté avec l'évolution des situations dans d'autres parties du monde, par exemple dans les Caraïbes et en Afrique australe. De nouveaux cas d'apatridie sont constamment générés par des lacunes dans les lois sur la nationalité, qui rendent des enfants apatrides dès leur naissance, le plus souvent car leurs parents le sont eux aussi. Nous sommes également préoccupés par de nouveaux cas générés par des successions d'Etats comme la récente indépendance du Soudan du Sud. Si les lois relatives à la nationalité ne sont pas bien élaborées ou mises en œuvre, des milliers de personnes peuvent tomber à travers les mailles du filet, par exemple pour l'ancienne Union soviétique et cela prend des années pour les résoudre. Il reste plus d'un demi-million d'apatrides dans l'ex-Union soviétique.
Que signifie l'apatridie pour les personnes dans leur vie quotidienne ?
C'est la question clé. Si on comprenait mieux le terrible impact de l'apatridie sur la vie quotidienne, il serait plus facile de mobiliser les gouvernements pour qu'ils prennent des mesures appropriées. Généralement, les apatrides vivent dans leur pays de naissance. Cependant, ils n'ont pas de résidence légale ni de documents d'identité. Ceci a de graves conséquences car l'absence de statut légal signifie généralement les enfants ne peuvent être enregistrés à la naissance ni aller à l'école. Souvent, les apatrides ne peuvent pas travailler légalement, ni être propriétaires de leur terrain, ni conclure des contrats, ni hériter de biens, ni ouvrir des comptes bancaires... J'en ai rencontré qui avaient peur de quitter leur maison car ils peuvent être arrêtés par la police sans pouvoir prouver leur identité. Les apatrides disent souvent qu'ils ont des difficultés à se marier. Ceux qui se marient décident de ne pas avoir d'enfants, car ils seraient eux aussi apatrides. Nous avons rencontré beaucoup d'apatrides brillants qui réussissent à obtenir des diplômes mais qui ne peuvent pas progresser professionnellement, car ils n'ont pas de nationalité. Ils finissent par accepter des emplois peu rémunérés. Et il y a un impact psychologique majeur dans de nombreux cas, y compris la dépression avec de forts sentiments d'impuissance, de frustration et d'exclusion.
Qu'a entrepris le HCR pour éliminer l'apatridie et quels sont les principaux défis ?
La première étape consiste à identifier est apatride, comment ils le sont devenus et à examiner les obstacles à l'acquisition de la nationalité. Nous faisons précisément ce travail actuellement dans de nombreux pays à travers le monde, y compris dans plusieurs anciens Etats soviétiques. Quand nous avons mieux compris le problème, nous pouvons discuter avec le gouvernement sur le motif de notre action. C'est parfois un défi majeur car la question de la nationalité est au cœur même de l'identité de l'État. Qui est citoyen et qui ne l'est pas ? Souvent des divisions historiques au sein de la population sont en cause et, bien souvent, les apatrides appartiennent à des minorités, comme les Rohingyas en Birmanie. Une fois qu'il y a une certaine reconnaissance du problème, nous pouvons commencer à discuter de changements nécessaires dans la législation et les procédures de nationalité ou de toute autre action requise.
Souvent, quelques changements mineurs dans la loi et l'introduction de procédures simplifiées pour l'acquisition de la nationalité peuvent permettre à de nombreux apatrides d'acquérir la nationalité dans un délai relativement court, généralement à un faible coût. Il est également important d'éviter de nouveaux cas. Une étape clé consiste à assurer que chaque enfant né apatride acquiert la nationalité du pays dans lequel il ou elle est né(e). Cela brise le cycle de transmission de l'apatridie, d'une génération à l'autre et c'est l'une des garanties fondamentales contre l'apatridie inscrites dans la Convention de 1961.
Pourquoi certains pays sont-ils réticents à adhérer aux deux conventions ?
Souvent, ce n'est pas une question de réticence, mais d'un manque de connaissances sur les conventions et leur importance. Jusqu'en 1995, aucune organisation internationale ne faisait la promotion de ces deux conventions. Depuis lors, le HCR a œuvré dans le cadre de son mandat sur l'apatridie reçu de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous avons constaté que la plupart des gouvernements sont réceptifs lorsque les avantages des conventions sont expliqués. En particulier, il est dans l'intérêt de tous – les États et les apatrides – qu'il existe des lois applicables à tous les pays. Un grand nombre de gouvernements en conviennent, ce qui explique pourquoi 33 États se sont engagés à adhérer à l'une ou aux deux conventions en 2011 et également pourquoi nous allons probablement obtenir une ratification quasi universelle de ces conventions dans les Amériques et en Europe dans un avenir proche, ainsi qu'un très haut niveau en Afrique. Bien sûr, il y a des Etats dans différentes parties du monde qui ne sont pas susceptibles d'adhérer dans un avenir proche. Par exemple, la Convention de 1961 exige que les États aient des garanties dans leurs lois sur la nationalité pour éviter l'apatridie, mais certains pays ont des lois sur la nationalité très problématiques et ne sont pas enclins à en changer dans l'objectif d'adhérer à la Convention de 1961.
Sur quoi travaillez-vous maintenant et dans quel objectif ?
Nous constatons des progrès. Le 50e anniversaire de la Convention de 1961 en 2011 a marqué un tournant. En travaillant avec un petit nombre de pays et d'ONG champions, nous avons pu expliquer pourquoi de nombreux gouvernements doivent se sentir concernés par l'impact de l'apatridie sur les individus et la société en général. Depuis lors, nous avons entendu un nombre croissant de gouvernements dire que l'apatridie n'est pas acceptable et prendre des mesures pour y remédier. En fait, plus de 60 gouvernements se sont engagés à prendre des mesures sur ce problème en 2011 et un quart d'entre eux ont réformé leurs lois sur la nationalité et mis en œuvre des procédures pour identifier les personnes apatrides. Nous avons eu un nombre sans précédent d'adhésions aux conventions relatives à l'apatridie – 29 depuis le début de notre campagne en 2010. Pour mémoire, la Convention de 1961 n'avait recueilli que 15 adhésions au cours des trois décennies après son adoption. Seulement ces deux derniers mois, la Lituanie a adhéré à la Convention de 1961 et le Nicaragua aux deux Conventions. Nous avons été très heureux de constater que l'Assemblée nationale de Côte d' Ivoire a récemment approuvé l'adhésion aux deux Conventions. Il s'agit d'une étape importante vers la résolution des problèmes majeurs en matière d'apatridie en Côte d'Ivoire. Nous encourageons les autres États à faire preuve d'autorité sur cette question en adhérant aux conventions.
L'apatridie sera-t-elle un jour complètement éradiquée à travers le monde ?
Nous sommes très heureux des progrès enregistrés ces dernières années mais, clairement, ce n'est pas suffisant. La population apatride mondiale reste élevée. Nous l'estimons à plus de 10 millions de personnes. Pourtant ces dernières années, seul un petit pourcentage a acquis la nationalité chaque année, soit environ un pour cent. Pour faire changer les choses, nous devons voir des avancées dans les pays comptant d'importantes populations apatrides. L'année prochaine sera le 60e anniversaire de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et l'un de nos principaux messages portera sur le fait que l'apatridie peut être éradiquée. Cependant, pour y parvenir, davantage de décideurs doivent comprendre que c'est l'une des crises de droits humains les plus négligées de notre époque et qu'il faut prendre des mesures.