Est-ce mal d'aimer ?
Des réfugiés LGBTI au Canada racontent leur périple pour trouver la sécurité et parlent fièrement d'eux-mêmes.

Portraits de réfugiés LGBTI vivant au Canada, photographiés par des jeunes de communautés sous-représentées, dans le cadre de l'exposition "Am I Wrong to Love" organisée par JAYU et UNHCR Canada. ©
Ils ont été battus, torturés, leurs vies ont été menacées… Simplement pour aimer qui ils aimaient et refuser de dissimuler qui ils étaient vraiment. L'exposition photo Est-ce mal d'aimer ? organisée par JAYU, une organisation à but non lucratif, avec le soutien du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, présente les portraits et les récits personnels de réfugiés et de demandeurs d'asile LGBTI vivant au Canada.
Ces portraits intimes et créatifs ont été tirés par de jeunes Canadiens appartenant à des communautés défavorisées dans l'atelier photo de JAYU. Bushira Nakitende, 19 ans et originaire d'Ouganda, comptait parmi les photographes. Elle a fait le portrait de Biko, une militante kenyane, réfugiée et transsexuelle.
« Elle a vraiment beaucoup de force », dit Bushira. « Imaginez être réfugiée et devoir lutter pour protéger votre vie parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous êtes. »
Dans ce portrait, Bushira voulait symboliser l’admiration qu’elle voue à Biko : « Elle portait beaucoup. Enlever ce manteau, c'était comme lâcher ce poids. Et elle ne fait que s'épanouir. »
À la fin de la séance photo, Bushira avait le sentiment que Biko faisait partie des siens. Elle lui a dit ce que l'exposition cherchait à transmettre silencieusement : « Je ressens ta souffrance. Tu n'es pas seule. Nous t'aimons. »
Voici quelques-uns des portraits de cette exposition et des récits relatés par les réfugiés et les demandeurs d'asile eux-mêmes.

« Quand j'étais jeune, c'était difficile de comprendre ce que ça voulait dire « transsexuelle » parce qu'il n'y avait pas de mots pour l'expliquer. »
Biko Beauttah, Kenya
Au Kenya, si vous vous dites gay, lesbienne, bisexuelle ou trans, ça pourrait très mal aller pour vous. Quand j'étais jeune, c'était difficile de comprendre ce que ça voulait dire « transsexuelle » parce qu'il n'y avait pas de mots pour l'expliquer et aussi simplement parce que les trans ne se montraient pas publiquement. J'ai toujours senti que j'étais différente, mais spéciale aussi. Je suis allée aux États-Unis pour mes études universitaires et c'est là que je suis allée pour la première fois dans un club gay où j'ai rencontré Maya Douglas, la première trans que j'ai jamais rencontrée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert non seulement ce que signifiait être transsexuelle, mais aussi que c'était comme ça que je me considérais. Je me suis sentie libérée. Cette année-là pour Halloween, je me suis habillée en femme pour la première fois et j'ai eu le sentiment d'être enfin dans ma propre peau. Je savais que je ne pouvais pas retourner au Kenya où je risquais la mort et c'est pourquoi j'ai demandé l'asile au Canada en 2006. À mon arrivée, j'ai été détenue pendant 36 heures et j'ai passé mes six premiers mois au Canada dans un foyer pour réfugiés avant qu'un propriétaire n'accepte de me louer un appartement. Je suis passée à l'émission de Tyra Banks et maintenant je pose pour Nordstrom [une chaîne de mode]. Malgré ma réussite, je suis toujours confrontée à la transphobie ici au Canada, comme tous les autres trans à travers le monde.

« J'ai tout de suite su que pour moi, la vie au Pakistan ne serait plus jamais confortable ou sûre. »
Muhammad Adeel Iqbal, Pakistanais, 39 ans
Au Pakistan, l'homosexualité est considérée comme un péché majeur. On ne peut tout simplement pas en parler. Si vous vous révélez, vous passerez le reste de votre vie en prison. J'ai commencé à comprendre que j'étais gay à environ 15 ans. Je sortais avec mes copains et il y en avait un avec qui je passais beaucoup de temps. J'avais 18 ans lorsque nous avons couché ensemble. Parce que l'homosexualité est inacceptable au Pakistan, j'ai épousé une femme à 27 ans. On a eu un enfant. J'avais toujours des relations sexuelles avec d'autres hommes en cachette. Un soir, la police a fait irruption dans une partie gay à Lahore. J'ai réussi à m'enfuir, mais la police a continué de me rechercher et m'a inculpé. J'avais un frère qui vivait à Toronto et j'ai demandé l'asile au Canada. Je suis arrivé au Canada en octobre 2018. La police a fait une descente à mon domicile au Pakistan et a émis un mandat d'arrêt. C’est en lisant le mandat que ma femme a appris que j'étais gay. Elle a informé les membres de ma famille qui ne m'ont plus adressé la parole et m’ont renié. J'ai tout de suite su que pour moi, la vie au Pakistan ne serait plus jamais confortable ou sûre. Bien que mon frère vive ici au Canada, il a quand même été irrité et contrarié en apprenant que j'étais gay. Je ne peux pas vous dire combien cette situation est difficile pour moi. Je me suis fait quelque amis ici au Canada et je suis bien plus heureux de l'orientation que prend ma nouvelle vie. Je me sens en sécurité.
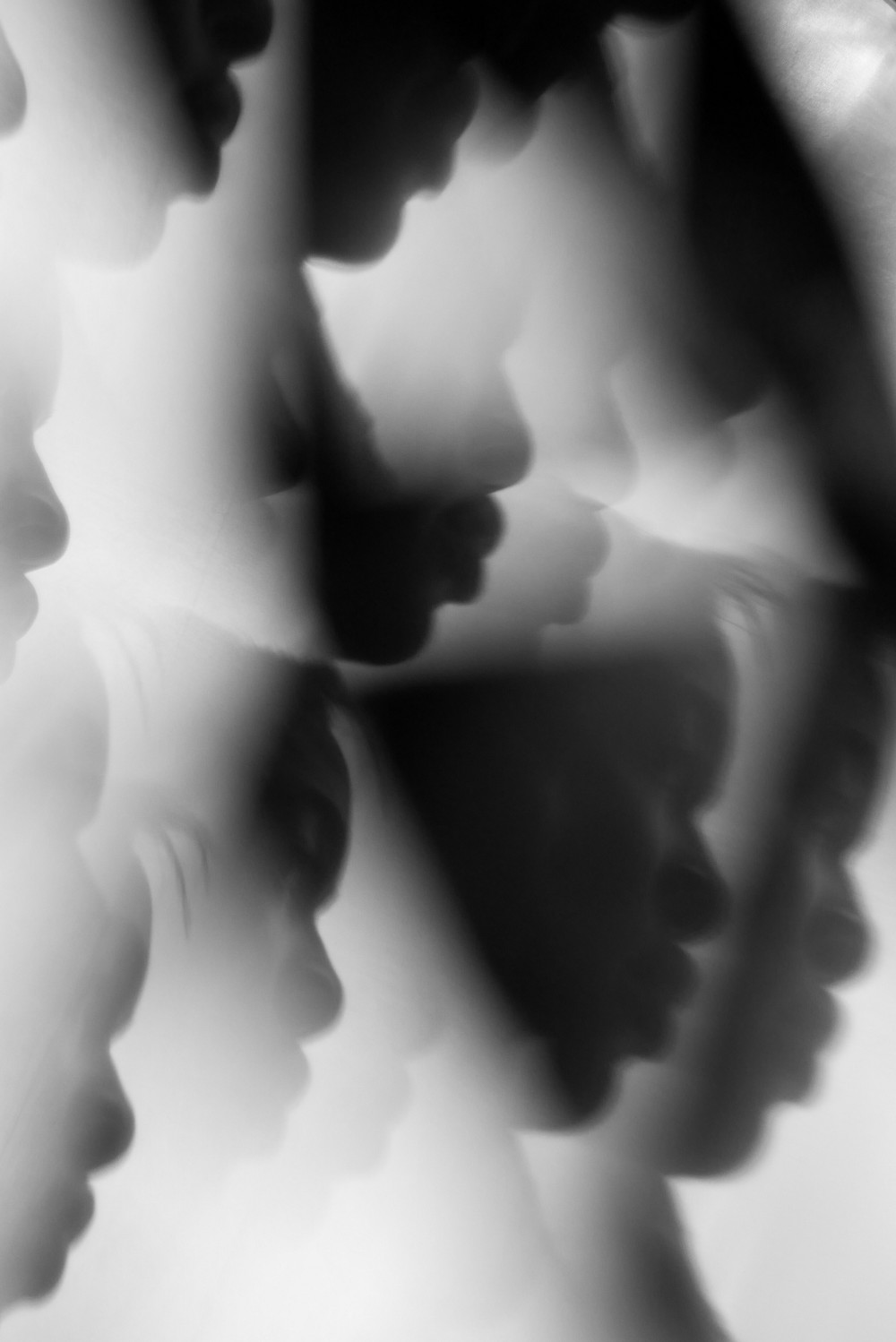
« Même s'ils croyaient m'avoir guérie, moi je savais que rien n'avait changé. »
Nicole, Camerounaise, 25 ans
Au Cameroun, si on est gay ou lesbienne, les gens pensent qu'on est malade ou qu'on vous a jeté un sort. J'ai couché quelquefois avec des garçons au lycée, mais je n'ai jamais eu le sentiment d'être amoureuse. Tout a changé quand j'ai rencontré une fille et qu'on a commencé à passer beaucoup de temps ensemble. Une nuit, on s'est embrassé, mais je n'étais toujours pas très sûre de savoir ce que ça voulait dire être lesbienne. Je pensais que c'était juste la tempête hormonale de l'adolescence. On s’est encore embrassé à l'école et on s'est fait prendre. Mes parents ont dit qu'ils ne toléreraient pas ça. J'ai eu une semaine d'exclusion. J'ai commencé à me faire maltraiter. J'ai eu la chance d'avoir une bourse pour aller au Royaume-Uni. C'est là-bas que j'ai compris que j'étais lesbienne. J'ai aussi su que je ne serais jamais en sécurité ou que je ne pourrais jamais être moi-même si je rentrais dans mon pays, alors j'ai fait une demande de bourse pour étudier aux États-Unis et je suis allée vivre en Oklahoma pendant quatre ans. Ma mère est décédée et j'ai dû rentrer au Cameroun pour les obsèques. Pendant mon séjour là-bas, des membres de ma famille ont découvert mon orientation sexuelle. Ils m'ont déshabillée et m'ont clouée sur une chaise en plein milieu du village pour réaliser une cérémonie en pensant que ça me guérirait. Ils ont prononcé des incantations en langue, poussé des cris et versé sur moi de l'eau ou je ne sais pas quelle potion. J'ai pleuré et appelé à l'aide pendant trois ou quatre heures. Même s'ils croyaient m'avoir guérie, moi je savais que rien n'avait changé. Ma sœur qui vivait au Canada est tombée en dépression après la mort de ma mère et je suis allée là-bas pour l'aider. J'ai toujours pensé que ce serait temporaire, mais c'est à ce moment-là qu'un ami gay m'a dit que je devrais faire une demande d'asile. J'ai finalement décidé d'en parler à ma sœur et même si elle était très en colère, elle a commencé à me soutenir.

« Mon père m'a renié et jeté dehors. »
Antoine*, Nigérian, 28 ans
Pendant mon adolescence, on se moquait de moi parce que je « marchais comme une femme. » Mes parents m'ont surpris avec un garçon quand j'avais 13 ans. Quand mon père m'a trouvé, il m'a battu si fort que j'ai toujours la cicatrice sur mon bras droit et en m’enfuyant, je suis tombé et je me suis cassé les dents de devant. Je ne peux toujours pas oublier ces souvenirs. J'ai changé d'école et déménagé. Des années ont passé avant que j'aille à l'université où j'ai rencontré un autre homme qui est devenu ensuite mon compagnon. On est sorti ensemble en secret pendant trois ans avant d'être surpris par sa famille. J'ai continué à cacher mon homosexualité à ma famille, mais quand mon compagnon est tombé gravement malade, je n'ai pu qu'en parler à ma mère. Elle en a parlé à ma famille, mon père m'a renié et jeté dehors. Ma mère m’a trouvé un endroit où habiter et a toujours essayé de me protéger, mais j'ai fini par me dire que le Nigéria n'était plus sûr pour moi. Très rapidement, ma mère a fait ce qu'il fallait pour que je parte à Toronto, au Canada. Je suis arrivé ici en août 2018 et je ne connaissais personne. À mon arrivée au Canada, j'ai dû vivre dans un foyer, mais maintenant je suis indépendant et j'attends l'audition de détermination de ma demande de réfugié. Ma mère est la seule raison que j'ai d'être en vie aujourd'hui. Je rêve de la retrouver un jour à l'aéroport de Pearson et de la voir fière de son fils.

« Quand on est arrivé à Toronto, on était tellement heureuses qu'on en a pleuré. »
Nouran Hussein, Égyptienne, 23 ans
La première fois que j'ai senti que j'étais peut-être lesbienne, c'était au début du collège, mais ce n'est qu'au lycée que j'ai vraiment accepté de voir les choses en face. J'ai fait bien attention de garder le secret et de n'en parler à personne. J'appartiens une famille musulmane et j'avais le sentiment que je ne pourrais jamais leur dire la vérité. J'étais déjà à l'université quand ma famille a fouillé dans mon téléphone et trouvé des messages échangés avec ma partenaire. Ils m'ont battue, refusant d'accepter la réalité. Ils m'ont même fait interner dans un hôpital psychiatrique pendant une semaine. En Égypte, la communauté LGBTQ vit dans le secret absolu et personne ne peut révéler son orientation sexuelle parce qu'on risque d'être arrêté par la police et torturé. J'ai rencontré ma partenaire Miral sur Instagram. Comment on se savait en danger, on a cherché à s’échapper. On a d'abord voyagé un peu partout en Égypte en se cachant jusqu'à ce qu'on obtienne un visa de départ en tant que réfugiées. On est arrivé à Toronto en juin 2018 et ni elle ni moi n'avons plus de rapports avec nos familles. On n'aurait jamais pu imaginer qu'il y avait un endroit dans le monde où on pouvait se promener librement en se tenant la main et s'embrasser en public. Quand on est arrivé à Toronto, on était tellement heureuses qu'on en a pleuré.

« La Côte d'Ivoire est un tout petit pays et les nouvelles vont vite. Je ne me sentais pas vraiment en sécurité où que ce soit. »
Hermann, Ivoirien, 24 ans
Se déclarer LGBTI en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. Si vous essayez de vous afficher publiquement avec la communauté LGBTI, vous vous ferez battre. Si vous parlez de votre différence aux membres de votre famille, en leur disant que vous aimez les hommes, ils penseront que vous êtes dérangé et on vous jettera la rue. J'ai rencontré un homme et on a commencé à avoir une relation ensemble, mais il fallait qu'on se cache. Les gens de ma famille pensaient que c'était juste un bon ami. Ce n'est que lorsque nous avons tous les deux obtenu une bourse d'études aux États-Unis que nous avons enfin commencé à nous sentir bien. Nous pouvions être nous-mêmes, avoir des marques de tendresse en public. Quand je suis retourné en Côte d'Ivoire un an plus tard, je savais que je ne pouvais plus me cacher et j'ai décidé d'en parler à ma famille. Avec ma mère, ça allait, mais mes oncles et les autres membres de ma famille ont dit que je ne pouvais plus vivre avec eux. Ils ont commencé à me menacer, à me dire qu'ils me tueraient et me feraient disparaître. C'était terrorisant. La Côte d'Ivoire est un tout petit pays et les nouvelles vont vite. Je ne me sentais pas vraiment en sécurité où que ce soit. Fort heureusement, j'avais dans mon passeport un visa canadien qui datait de l'époque où j'étais aux États-Unis et j'ai pris la décision de venir à Toronto. Je suis arrivé ici en septembre 2018 avec mon partenaire. On se sent vraiment à l'aise ici. Personne ne nous regarde ou pense que nous sommes bizarres parce que nous nous tenons la main en public.

« J'ai commencé à recevoir des menaces de mort et il fallait toujours que je regarde derrière moi. »
Durene*, Jamaïcaine, 19 ans
J’avais environ 12 ans quand j'ai pris conscience que j'étais lesbienne. J'ai été élevée dans une famille chrétienne, avec une mère et des frères et sœurs qui étaient incapables d'accepter mon homosexualité. J'ai donc décidé de n'en parler à personne et de garder ça pour moi. Je suis sortie en secret avec une personne qui se disait bisexuelle et ça n'a pas été facile. Pas question de se témoigner la moindre marque d'affection en public à cause de l'homophobie qui règne en Jamaïque. On a fini par se séparer parce qu'elle avait un petit copain à cette époque-là et ils ont fondé une famille. Puis, j'ai eu une relation de passage, toujours en secret, avec une autre fille de ma communauté. Quand on a couché ensemble, elle en a parlé à une amie et bien des gens ont fini par le savoir, dont ma famille. Ils ont vraiment mal pris la chose et se sont mis à me dire des choses très blessantes. J'ai commencé à recevoir des menaces de mort et il fallait toujours que je regarde derrière moi. Quelqu'un m'a prévenu que si j'allais à la police, ils tueraient ma mère. En 2018, j'ai été invitée à Toronto pour un tournoi de netball. Pendant que j'étais là-bas, j'ai reçu un coup de téléphone de ma sœur : mon jeune frère avait été assassiné par les mêmes personnes qui me menaçaient moi et les miens. Ma mère a réagi très durement et m'a accusée en disant que tout était de ma faute. J'ai demandé le statut de réfugié et j'attends mon audition. Ici, je me sens mieux soutenue et les gens avec qui j'habite me prennent telle que je suis.

« Vous ne pouvez pas vous révéler et vous exprimer librement. Si vous le faites, vous serez battu ou torturé. »
Jeff*, Ougandais, 35 ans
En Ouganda, personne n'a la moindre idée de ce que signifie être bisexuel ou transgenre. Les gens ne connaissent que les termes « gay » ou « lesbienne », et même ça, c'est complètement inacceptable. Vous ne pouvez pas vous révéler et vous exprimez librement. Si vous le faites, vous serez battu ou torturé. Même si vous allez à la police, vous vous ferez arrêter et torturer, mais certainement pas protéger. Il faut vous cacher du mieux possible. J'ai découvert que j'étais bisexuel au lycée en me rendant compte que j'étais plus attiré par les garçons que par les filles. L'un de mes amis m'a fait connaître un bar LGBTI clandestin et je me suis vraiment senti chez moi. J'ai rencontré des gens avec qui je pouvais connecter. Des années plus tard, j'ai commencé à travailler pour une organisation clandestine de défense des droits des LGBTI quand une femme lesbienne a été battue et torturée par des membres de la communauté. Nous avons essayé d'aller à son secours et la police nous a arrêtés et inculpés au motif que nous cherchions à promouvoir l'homosexualité. Nous avons été battus et torturés. Ça a atteint un stade où j'ai commencé à craindre pour ma vie et à me dire qu'il fallait que je quitte l’Ouganda. Mes rapports avec ma famille étaient tendus. Des rumeurs ont aussi commencé à circuler comme quoi la communauté LGBTI soutenait et finançait l'opposition politique et de nombreux membres de notre communauté ont été pris pour cible et se sont fait confisquer leurs ordinateurs. Je suis arrivé au Canada en 2018. J'ai demandé le statut de réfugié et j'attends mon audience. Je vis maintenant à Toronto où je me sens libre et en sécurité.

« Tout ce auquel je pouvais penser, c'était de m'enfuir. »
Carine*, Camerounaise, 45 ans
La première fois que j'ai eu des rapports sexuels, c'était avec une fille au collège. Au Cameroun, c'est très commun de se marier à la fin de l'école secondaire. Mes parents avaient entendu des rumeurs comme quoi j'étais lesbienne et ils m'ont forcée à épouser un homme. Nous sommes restés mariés 20 ans et j'ai eu trois enfants. Je travaillais comme infirmière dans un commissariat de police et j'ai assisté trop souvent à des arrestations de personnes LGBTI qui étaient gardées en détention. Elles étaient battues, torturées et parfois tuées. Souvent, des homosexuels mouraient en détention et il n'y avait pas d'enquête. J'avais une relation secrète avec l'une de mes collègues. Elle était mariée elle aussi. Un jour, nous avons été surprises dans le parking et la police en a parlé à nos maris. Mon mari a appelé ma famille et leur a tout révélé. Nous avons été surprises une autre fois dans un hôtel et le mari de ma partenaire nous a sauvagement battues. Je me rappelle m'être enfuie de l'hôtel toute nue. Bien que déçus, les gens de ma famille n'ont rien dit, mais ils ne m'ont jamais revue parce que je suis restée cachée. Tout ce auquel je pouvais penser, c'était de m'enfuir. Deux de mes trois enfants étaient venus étudier au Canada et j'ai décidé de les rejoindre en 2016. Au Canada, je me sens à l'aise parce que j'ai le sentiment que je peux faire ce que je veux sans la moindre crainte. Mon mari et moi avons divorcé et il s'est remarié depuis avec une autre femme. Peu de temps après, mon troisième enfant est venu nous rejoindre ici pour être avec nous.

« On ne peut même pas prononcer le mot « gay » en public parce que les gens se mettent en colère. »
Rajesh Sakthivel, Indien, 35 ans
L'Inde est un pays très traditionnel à majorité hindouiste. Les gays et les lesbiennes n'y sont pas acceptés. On les croit incultes et irresponsables. On ne peut même pas prononcer le mot « gay » en public parce que les gens se mettent en colère. Même les familles n'hésitent pas à renier l'un des leurs si l'on découvre son homosexualité. Quand j'étudiais pour ma licence, j'habitais dans un foyer où je partageai une chambre avec un autre homme. Quelque temps après, nous avons eu des rapports sexuels et c'est là que j'ai compris que j'étais gay. La famille de cet homme s'en est rendu compte et ils étaient hors d’eux. Il a fini par épouser une femme, mais ça ne nous a pas empêché de poursuivre notre relation sexuelle. Au final, on m'a mis dehors et presque tout de suite après, des hommes ont été envoyés pour me bastonner. Ils m'ont brisé les côtes et je ne pouvais presque plus respirer. Je suis allé à l'hôpital et j'ai parlé à la police, mais ils ont menacé de me castrer et m'ont jeté en prison pendant deux jours. Après cet incident, j'ai déménagé dans le Gujarat, une autre province. Le gang qui m'avait déjà attaqué m’a retrouvé et a menacé de me tuer. Je suis revenu à Chennai, conscient que je ne serai jamais en sécurité où que ce soit en Inde. J'ai parlé à quelqu'un de ma situation et j'ai obtenu un visa pour venir au Canada. Je suis arrivé ici en 2018 et je me sens libre.
* Noms modifiés pour des raisons de protection.
