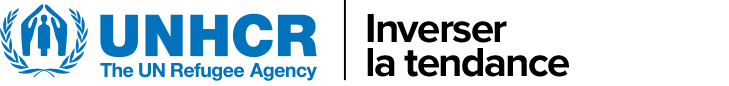Rihanna Siraj, réfugiée éthiopienne âgée de 15 ans, fréquente l’école du camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya. Elle compte parmi des millions d’élèves réfugiés auparavant déscolarisés qui vont maintenant à l’école primaire grâce au soutien du programme Educate A Child (Éduquer Un Enfant). © HCR/Anthony Karumba
À propos de ce rapport
Ce rapport présente le parcours de certains parmi 7,4 millions d’enfants réfugiés en âge scolaire et relevant de la compétence du HCR. En outre, il examine les aspirations éducatives des jeunes réfugiés qui désirent continuer à étudier après le secondaire, et souligne le besoin de partenariats robustes pour lever les barrières à l’éducation au bénéfice de millions d’enfants réfugiés. Les statistiques sur les inscriptions scolaires des réfugiés et les effectifs de population sont tirés de la base de données sur les populations relevant de la compétence du HCR, des outils pour rapporter les données et des enquêtes sur l’éducation pour l’année 2017. Le rapport fait également référence aux données mondiales de l’Institut de statistique de l’UNESCO sur l’inscription des élèves, relatives à 2016.
Introduction – Il est temps d’inverser la tendance
Par Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, rencontre Mohammad, un réfugié syrien âgé de 7 ans, lors d’une visite à l’Institut du Père Andeweg pour les Sourds (FAID – Father Andeweg Institute for the Deaf) à Beyrouth, au Liban. © HCR/Claire Thomas
Début juillet, je me suis rendu dans l’installation de réfugiés de Kutupalong, au Bangladesh, qui est devenu le foyer de centaines de milliers de réfugiés rohingyas ayant fui une violence effroyable au Myanmar. Dans un centre d’apprentissage doté d’une salle unique, alors que les pluies de la mousson frappaient le toit, j’ai vu des filles et des garçons apprendre les bases de la lecture, de l’écriture et des mathématiques pendant seulement deux heures par jour, avant qu’un autre groupe ne prenne leur place.
C’était déchirant d’être témoin de ce semblant de scolarisation à laquelle ces jeunes réfugiés ont pourtant droit. Mais cela prouve aussi à quel point ils valorisent l’éducation : sans elle, leur avenir en sera irrémédiablement affecté ainsi que celui de leurs communautés.
Bangladesh : Une première salle de classe pour les enfants réfugiés rohingyas. Photo © HCR/Adam Dean
La moitié des réfugiés du monde sont des enfants. Parmi ceux en âge scolaire, plus de la moitié ne vont pas à l’école – ce qui équivaut à quatre millions de jeunes non scolarisés, alors qu’ils débordent de potentiel.
Le nombre d’enfants réfugiés non scolarisés a augmenté de 500 000 au cours de la dernière année seulement. Si les tendances actuelles se poursuivent et à moins que des investissements urgents ne soient réalisés, alors des centaines de milliers de nouveaux enfants réfugiés viendront s’ajouter à ces statistiques inquiétantes.

Les Etats membres des Nations Unies se sont engagés à assurer, dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, « une éducation de qualité inclusive et équitable » et à promouvoir « des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie ». Dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2016, les gouvernements se sont engagés à partager la responsabilité à l’égard des réfugiés dans le monde et à améliorer l’accès à l’éducation pour les enfants réfugiés,
Ce sont des engagements importants. Mais ceux-ci n’auront de substance pour les jeunes réfugiés que lorsqu’ils verront un réel changement et auront les mêmes chances d’accès à l’école que les autres. Il est temps d’honorer ces promesses et d’inverser la tendance, comme le précise notre rapport annuel sur l’éducation des réfugiés.
Cette même violence et ces mêmes persécutions qui extirpent les gens de leurs foyers, qui détruisent le vie des familles stables et qui obligent bon nombre à sombrer dans la pauvreté, sont tout autant nocives à l’intégrité physique, psychologique et développementale des enfants. Quand les crises de réfugiés s’aggravent et se multiplient, les enfants sont souvent les plus touchés.
Photo © HCR/Houssam Hariri
« J’ai aimé dès le premier jour. J’avais raté deux ans d’école à cause de la guerre. »
Moaed, réfugié syrien âgé de 13 ans, fréquente l’école Bar Elias dans la plaine de la Bekaa au Liban. Il s’agit d’une école parmi 350 autres au Liban qui proposent des cours supplémentaires pour servir davantage d’élèves réfugiés. Les équipes de l’après-midi ont permis à plus de 150 000 enfants réfugiés de s’inscrire à l’école au Liban.
Mais les enfants sont extraordinairement résilients. En apprenant, jouant et explorant, ils trouvent des moyens de faire face, de progresser et même de s’épanouir s’ils en ont la possibilité. Pour le HCR, l’éducation est actuellement fondamentale dans chaque situation d’urgence de réfugiés. Pourquoi ? Parce que les réfugiés passent maintenant plusieurs années en exil, voire des décennies – une période qui s’étend souvent sur l’enfance entière et au-delà.
Il arrive que beaucoup d’enfants et de jeunes soient déplacés à plusieurs reprises avant de traverser une frontière et de devenir réfugiés. Pour les enfants dont la vie a été bouleversée de cette manière, l’école est souvent le premier endroit où ils commencent à regagner une certaine normalité – la sécurité, l’amitié, l’ordre, la paix. Peu importe leur nationalité, leur statut légal ou celui de leurs parents, les enfants ont droit à ces activités académiques et parascolaires qui leur permettront de prospérer.
Mais seulement deux heures d’éducation de base, comme j’ai pu l’observer, ce n’est pas suffisant. Les enfants ont besoin d’un vrai programme scolaire tout au long du primaire et du secondaire, qui mène à des qualifications reconnues pouvant servir de tremplin pour l’université ou pour une formation professionnalisante.
Pour répondre à cet objectif, les enfants réfugiés ont besoin d’être inclus dans les systèmes d’éducation nationaux de leurs pays d’accueil – des systèmes qui sont régulés, contrôlés et à jour. Au Bangladesh, beaucoup d’enfants rohingyas vont à l’école pour la première fois. C’est un progrès important, mais leur potentiel est dramatiquement limité par le fait qu’ils ne suivent aucun programme officiel, et que trop souvent les professeurs manquent de formation.

Des enfants réfugiés rohingyas ramassent du bois de chauffage en bordure de forêt dans l’installation de réfugiés de Kutupalong, au Bangladesh. De nombreux enfants rohingyas manquent l’école à cause des tâches ménagères, de pressions sociales, de mariages précoces et de difficultés d’accès à l’école. © HCR/Roger Arnold
Malgré tout, la force de l’école, c’est bien plus que les seules qualifications académiques. L’éducation est une façon d’aider les jeunes à cicatriser, mais c’est aussi la manière de redonner vie à des pays entiers. Si on leur permet d’apprendre, de se développer et de s’épanouir, les enfants grandiront pour contribuer à la fois aux sociétés qui les accueillent et à leur pays de naissance lorsque la paix leur permettra de revenir. C’est en cela que l’éducation est l’un des moyens les plus importants de résoudre les crises mondiales.
En suivant le sort des jeunes réfugiés qui ont eu la possibilité d’être scolarisés, nous avons constaté que certains poursuivent leurs rêves de devenir chirurgiens, pilotes, avocats, statisticiens, journalistes, leaders de communautés, biologistes moléculaires et enseignants pour les générations futures.

Madina, réfugiée afghane âgée de 16 ans, vivant à Bruxelles, en Belgique, rêve de créer une école pour filles en Afghanistan. « Je veux que toutes les filles en Afghanistan sachent qu’elles peuvent faire tout ce que les garçons peuvent faire. » © HCR/Humans of Amsterdam/Fetching Tigers. Extrait de l’histoire par @humansofamsterdam
Mais nous avons également vu des rêves se briser. Moins du quart des réfugiés dans le monde se rendent à l’école secondaire et seulement un pour cent progresse vers l’enseignement supérieur. Les régions en développement, où les écoles sont souvent terriblement sous-équipées, ont accueilli 92 pour cent des réfugiés du monde en âge d’aller à l’école. Ces gouvernements ont besoin de soutien pour inclure les enfants réfugiés dans les systèmes éducatifs nationaux – comme certains s’efforcent effectivement de le faire – et pour développer les infrastructures nécessaires.
Nous ne pouvons pas construire un avenir en mettant de côté les enfants réfugiés dans un système de scolarisation parallèle qui repose sur des matériels obsolètes, des salles de classe de fortune ou des enseignants non formés. On ne peut pas improviser une scolarité et imaginer que c’est suffisant.
Les organisations humanitaires, les gouvernements et le secteur privé doivent s’unir pour augmenter le financement de l’éducation et concevoir des solutions plus innovantes et durables pour répondre aux besoins éducatifs spécifiques des réfugiés. Nous devons construire sur la promesse de la Déclaration de New York et commencer à transformer les mots en actes. Le Pacte mondial sur les réfugiés, qui sera adopté par l’Assemblée générale à la fin 2018, énonce les dispositions pratiques visant à atteindre cet objectif, avec pour but de renforcer l’autonomie des réfugiés et d’alléger la charge pour les pays hôtes.
Cet effort mondial qui vise à transformer la vie des réfugiés doit inclure une volonté concertée pour donner lieu à plus de possibilités et de ressources en matière d’éducation. Ce faisant, nous remettrons leur avenir en marche et enrichirons notre monde.