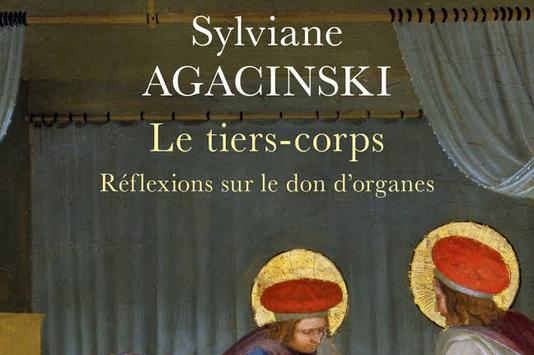
Livre. Cœur, poumons, intestin, foie, pancréas, cornée… A notre mort, et sous réserve qu’ils s’y prêtent, plusieurs de nos organes peuvent encore « dépanner » et réparer un autre corps. Si cette « transmission de quelque chose de soi après la mort, par solidarité avec les autres », ne pose, sur le principe, « guère problème » à Sylviane Agacinski, la philosophe conteste en revanche la façon dont la loi a organisé le consentement à ce don. « L’impératif d’efficacité est redoutable si, au nom de la noblesse des fins, il conduit à se dispenser de juger des moyens », écrit-elle dans Le Tiers-Corps, un ouvrage qui explore les nombreuses questions éthiques et morales soulevées par ce « don de soi » si particulier.
La loi Cavaillet, qui encadre depuis quarante ans le don d’organes en France, prévoit en effet que toute personne qui ne s’est pas explicitement opposée de son vivant à faire don de ses organes y consent. Le donneur est donc un « non-refusant », explicite la philosophe, pour qui ce « régime de prélèvement d’office » est assimilable à un « service civil post mortem ».
En gommant la dimension volontaire du don, la loi en perd le sens, estime-t-elle. Développant à l’extrême la logique de la législation, elle demande : « Pourquoi, demain, ne pourrait-on pas, par exemple, décréter qu’il est possible d’utiliser le corps de tous les morts pour la recherche ? »
« Logique “productiviste” »« La notion de consentement présumé est donc un paradoxe, voire un stratagème destiné à laisser entendre que, pour le don post mortem, s’applique une forme spéciale de consentement, alors qu’il s’agit de renoncer au consentement du défunt », souligne-t-elle.
A l’origine de sa réflexion, le débat, né en 2015, de la tentative du député Jean-Louis Touraine (LRM, ex-PS) de durcir la loi Cavaillet. Pour diminuer les refus des familles (de l’ordre de 30 % en...


