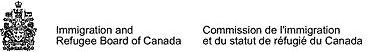Pakistan : Conflits violents entre les sectes
| Publisher | Canada: Immigration and Refugee Board of Canada |
| Author | Research Directorate, Immigration and Refugee Board, Canada |
| Publication Date | 1 July 1997 |
| Cite as | Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan : Conflits violents entre les sectes, 1 July 1997, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6a8204.html [accessed 4 June 2023] |
| Disclaimer | This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States. |
CARTE
GLOSSAIRE
1. INTRODUCTION
2. HISTORIQUE
3. GROUPES CHIÏTES
3.1 Tehrik-e-Jafria Pakistan (TJP)
3.2 Sipah-e-Mohammedi Pakistan (SMP)
4. GROUPES SUNNITES PRINCIPAUX
4.1 Jamiat-e-Ulema-e-Islam (JUI)
4.2 Sipah-e Sahaba Pakistan (SSP)
4.3 Lashkar-e-Jhangvi (LJ) et Harkat-ul Ansar (HUA)
5. AUTRES GROUPES SECTAIRES SUNNITES
5.1 Sunni Tehrik
5.2 Tehrik-e-Nifaz-e-Shariat-e-Mohammadi (TNSM)
5.3 Tehrik-e-Tulaba
5.4 Groupes jihadiques
6. RÉACTION DE L'ÉTAT
À PROPOS DE CERTAINES SOURCES
RÉFÉRENCES
CARTE
Source : Pakistan: A Country Study. 1984. p.xviii
GLOSSAIRE
Ahl-e Hadith (Peuple des traditions). Mouvement conservateur indo-musulman qui a vu le jour au XIXe siècle et qui prône des réformes wahabistes.
ATA Anti-Terrorism Act (loi sur la répression du terrorisme)
ATC Anti-Terrorism Court
Barelvis Une des principales sectes sunnites, de tendance conservatrice. Elle a vu le jour à Bareilly (Inde) au XIXe siècle comme un mouvement réformateur indo-musulman.
Deobandis Une des principales sectes sunnites, de tendance conservatrice. Elle a vu le jour à Deoband (Inde) au XIXe siècle comme un mouvement réformateur indo-musulman. Son orientation se rapproche de celle du mouvement wahabiste Ahl-e Hadith.
FATA Federally Administered Tribal Area (région tribale administrée par le gouvernement fédéral).
Hizb-e Wahdat Organisation d'activistes chiites dont la base se trouvait anciennement dans la région de Hazara (Afghanistan).
Hizb-ul Mujahideen (Parti des saints guerriers). Aile armée du mouvement Jamaat-e-Islami du Cachemire. Organisation qui prône le jihad et qui a des liens étroits avec le mouvement JI et son organisation soeur afghane Hizb-e Islami de Gulbuddin Hekmatyar.
HRCP Human Rights Commission of Pakistan (commission des droits de la personne du Pakistan, organisation non governementale).
HUA Harkat-ul Ansar. Organisation pakistanaise qui prône le jihad et qui est associée à la secte des deobandis. Entretient des liens étroits avec les organisations JUI et SSP ainsi qu'avec les talibans.
HUM Harkat-ul Mujahideen. Organisation appelée à prendre la relève de l'Harkat-ul Ansar.
ISI Inter-Services Intelligence (service de renseignements militaires).
ISO Imamia Students Organization
Islamic Ahl-e Hadith Parti politique formé à la fin des années 1970 pour faire contrepoids au militantisme chiite. Il suit la ligne du mouvement conservateur Ahl-e Hadith.
JI Jamaat-e-Islami (société islamique). Important parti sunnite de droite.
JUI Jamiat-e-Ulema-e-Islam (Conférence des oulémas de l'islam). Important parti islamiste de droite qui est associé à la secte des deobandis. Entretient des liens étroits avec les talibans. Sa principale faction, la JUI(F), est dirigée par Maulana Fazlur Rahman.
JUP Jamiat-e-Ulema-e-Pakistan (Association des oulémas du Pakistan). Parti religieux intégriste progressiste. Associé à la secte des barelvis.
Lashkar-e-Taiba (Armée des purs). Aile armée du groupe Markaz-e-Dawa-wal Irshad. Organisation qui prône le jihad et qui mène des opérations au Cachemire.
LJ Lashkar-e-Jhangvi (armée de Jhangvi). Aile armée du groupe SSP.
Markaz Markaz el-Dawa wa'l-Irchad (centre de propagation et d'orientation islamiques). Son orientation se rapproche de celle du mouvement wahabiste Ahl-e Hadith.
MQM Mouvement Mohajir Qaumi - parti ethnopolitique de Karachi.
MTC Military Trial Courts (tribunaux militaires)
MYC Milli Yakjehti Council (conseil de solidarité nationale). Créé au début de 1995 pour promouvoir les rapports harmonieux entre les sectes.
NWFP North West Frontier Province (Province frontière du nord-ouest)
OGD Observatoire géopolitique des drogues (organisation parisienne)
PML Pakistan Muslim League (ligue musulmane du Pakistan)
PPP Pakistan People's Party (parti du peuple pakistanais)
Shurae Wahdat-e Islami (Conseil de l'unité islamique). Nouvelle organisation-cadre chiite dont les activités empiètent sur le rôle traditionnel du TJP.
SMP Sipah-e Mohammedi Pakistan (gardiens du prophète au Pakistan). Groupe scissionniste armé du TJP. Chiite.
SSP Sipah-e Sahaba Pakistan (gardiens des amis du prophète au Pakistan). Sous-groupe activiste de la JUI. Il est associé à la secte sunnite des Deobandis.
Sunni Tehrik (Mouvement sunnite). Groupe scissionniste de la JUP, associé à la secte des barelvis.
Talibans Sunnites de la secte des deobandis; ils constituent le mouvement actuel au pouvoir en Afghanistan. Ils ont des liens étroits avec la JUI et le groupe SSP.
Tehrik-e-Tulaba (Mouvement étudiant). Groupe islamiste qui mène ses activités dans l'Orakzai Tribal Agency.
TJP Tehrik-e-Jafria Pakistan (mouvement pour le droit chiite). Important parti politique chiite, anciennement connu sous le nom de Tehrik-e Nefaz-e Fiqh-e Jafria (TNFJ).
TNFJ Tehrik-e Nefaz-e Fiqh-e Jafria (mouvement pour l'application du droit chiite). Groupe de pression chiite qui s'est constitué en réaction aux politiques du général Zia ul-Haq en matière d'islamisation. Prédécesseur du TJP.
TNSM Tehrik-e-Nifaz-e-Shariat-e-Mohammadi (mouvement pour la défense de la loi du prophète). Parti d'activistes tribaux qui mène ses activités surtout dans le Swat et les districts avoisinants de la Province frontière du nord-ouest. Wahabiste.
Wahabiste Au sens strict, un disciple de Mohammad ibn Abdul Wahab, penseur arabe influent du XVIIIe siècle. Au Pakistan, ce terme désigne souvent les membres de la secte des deobandis et les partisans de tout mouvement sunnite intégriste de réforme.
1. INTRODUCTION
Les conflits violents entre les sectes sunnites et chiites n'ont pas diminué en 1998 et au début de 1999 (Patterns of Global Terrorism: 1998 1999). Le massacre de 25 chiites qui pleuraient un défunt au cimetière de Mominpura à Lahore le 11 janvier 1998 a provoqué une série de représailles qui ont fait de 75 à 78 morts et 80 blessés dans la seule province de Pendjab au courant de l'année (HRCP 1999; Dawn 26 déc. 1998; Country Reports 1998 1999, section 5), et 150 morts dans l'ensemble du Pakistan (ibid.; HRCP 1999). Le bilan des morts, quoiqu'inférieur à celui de l'année précédente, était l'un des plus élevés depuis 1987 : mis à part 1997, il n'y avait eu qu'une seule autre année où le nombre de morts était plus élevé (Dawn 26 déc. 1998; HRCP 1998, 90, 136). Qui plus est, les représailles mutuelles, auparavant confinées aux districts méridionaux du Pendjab (FEER 9 mars 1995a, 24), se sont étendues aux grandes villes de la province (JIR janv. 1999, 33; Dawn 26 déc. 1998) ainsi qu'aux zones urbaines du Sindh et à la Province frontière du nord-ouest (NWFP) (Country Reports 1998 1999, section 1a; Jilani 1998, 126-127) et, ne se limitant plus à leurs cibles d'origine, ont abouti à des [traduction] « massacres de fidèles innocents appartenant aux deux croyances » (JIR janv. 1999, 35). L'analyste Anthony Davis, dans un article paru dans Jane's Intelligence Review, avance que la crise de la sécurité intérieure du Pakistan, dont les conflits violents entre les sectes constituent un élément, est maintenant devenue le [traduction] « danger le plus pressant » auquel doit parer le pays (ibid., 33).
Le présent exposé examine les groupes sectaires activistes les plus importants du Pakistan et fournit de l'information sur leur structure, leurs activités, leur histoire, leur idéologie, leur financement, leur dirigeants et leurs membres. Il examine également les rapports entre les divers groupes activistes ainsi que les relations entre les groupes activistes et leurs parrains ou leurs organisations mères. Il traite aussi du rôle joué par l'État dans la création des conditions propices à la naissance des organisations sectaires activistes, ainsi que des mesures prises pour freiner les conflits violents entre les sectes[1]1. Bien que l'exposé porte principalement sur le Pendjab, il jette également un coup d'oeil sur la situation ailleurs au Pakistan ainsi qu'en Afghanistan et au Cachemire, de manière à éclaircir les éléments transnationaux du problème. Le présent exposé n'examine pas les attaques et les incidents particuliers sauf dans les cas où ils servent à illustrer un aspect précis du tableau général. Il ne portera pas non plus sur les violences intercommunautaires, les lois sur le blasphème ou le traitement des minorités religieuses, ni sur les violences claniques, tribales ou ethnopolitiques à Karachi, sauf quand il y a chevauchement entre ces violences et les conflits violents entre les sectes.
2. HISTORIQUE
Il existe de nombreuses sectes et sous-sectes au Pakistan (Jilani 1998, 126-127; The Herald févr. 1999b, 59; The Economist 28 janv.-3 févr. 1995, 37). Selon une source d'information, le nombre de sectes et de sous-sectes musulmanes s'élève à 72 (Time 28 sept. 1998). La population sunnite appartient à quatre courants principaux - les deobandis, les barelvis, l'Ahl-e Hadith et les wahabistes; chacun de ces courants comporterait des dizaines de sous-groupes[2]2 (The Economist 28 janv.-3 févr. 1995, 37; The Herald févr. 1999b, 59; Jilani 1998, 126-127). Malgré ces divisions, la majorité des sunnites du Pakistan suivent l'école hanafie de la jurisprudence islamique (Islam and Islamic Groups 1992, 184; Contemporary Religions 1992, 452). Selon des estimations, les sunnites constituent 74 p. 100 de la population du Pakistan (ibid.). Pour ce qui du chiisme, il en existe trois courants au Pakistan : les ismailis, les Ithna Ashariyya et les bohras[3]3 (Islam and Islamic Groups 1992, 184). Les estimations du pourcentage de chiites dans la population du Pakistan varient énormément, allant de 5 p. 100 à 25 p. 100 (ibid.; Country Reports 1998 1999, section 2c); la plupart des sources d'information parlent d'un chiffre entre 15 p. 100 et 20 p. 100 (International Affairs 1997, 329; The Economist 28 janv.-3 févr. 1995, 37; Current History déc. 1997, 423; Contemporary Religions 1992, 452). Quoique peu nombreux, les chiites constituent néanmoins une minorité influente (Modern Asian Studies juill. 1998, 689, 707).
Selon une source d'information, les conflits entre les sectes pakistanaises auxquels on assiste depuis le début des années 1980 s'expliquent en grande partie par la même combinaison de problèmes politiques et économiques qui provoque des affrontements violents concernant des questions ethniques, linguistiques et autres (ibid., 714). D'autres sources désignent toutefois d'un doigt accusateur certaines politiques gouvernementales qui ont provoqué la création de groupes sectaires activistes et qui ont concouru à l'intensification des tensions entre les sectes au Pakistan (HRCP 1997, 87; JIR janv. 1999, 33-35; Jilani 1998, 126; Current History déc. 1997, 423). Il s'agit en premier lieu du programme d'islamisation du gouvernement Zia (1977-1988) qui, selon certaines sources, tentait de légitimer son régime militaire en accordant des privilèges à certains groupes religieux sunnites (ibid.; Modern Asian Studies juill. 1998, 693-695; JIR janv. 1999, 34). Ces politiques ont eu pour effet de radicaliser la population chiite et de provoquer la création d'organisation chiites activistes (Current History déc. 1997, 423; Modern Asian Studies juill. 1998, 697; The Herald juin 1994a, 35-36), en réponse à quoi les sunnites ont eux aussi créé des groupes activistes (Reuter 4 mai 1997; Modern Asian Studies juill. 1998, 704). D'autres causes importantes des conflits entre les sectes : la révolution iranienne de 1979 (Reuter 4 mai 1997; Modern Asian Studies juill. 1998, 704), la guerre de 1980 à 1988 entre l'Iran chiite et l'Irak sunnite (JIR janv. 1999, 35), et la lutte contre l'occupation soviétique de l'Afghanistan entre 1979 et 1989[4]4; dans le cadre de cette lutte, le Pakistan a été inondé d'armes, des dizaines de groupes islamistes activistes ont vu le jour, les groupes et les partis religieux se sont militarisés et la culture du jihad s'est répandue (ibid., 33-34; Current History avr. 1996, 160-161).
La prolifération des madrassas dans les années 1980 et les années 1990 a également concouru à aggraver les tensions entre les sectes (FEER 9 mars 1995b, 25; The Herald déc. 1997, 64; ibid. juin 1994b, 33; JIR janv. 1999, 34). Ces séminaires islamiques, situés souvent dans des mosquées ou dans des pièces voisines, dispensent un enseignement religieux aux garçons âgés entre 6 et 16 ans dont la plupart viennent de familles pauvres (ibid.; HRCP 1997, 173; The Herald déc. 1997, 64; HRCP 1998, 222). Parrainés par des partis politico-religieux et souvent financés par des donateurs du Moyen-Orient, les madrassas dispensent aux élèves un enseignement conforme aux croyances sectaires des parrains[5]5. (JIR janv. 1999, 34; HRCP 1997, 88-89, 173; Modern Asian Studies juill. 1998, 690; The Herald oct. 1996, 54), ce qui a fait dire à la Jane's Intelligence Review que les madrassas sont [traduction] « moins des centres de développement spirituel et plus un bouillon de culture de l'intolérance et de la haine sectaires » (janv. 1999, 34; voir également Choudary 29 mai 1999). La discipline dans ces écoles est très sévère (HRCP 1998, 223), et on y inculque aux élèves l'esprit du jihad (ibid.; The Herald déc. 1997, 64; AP 12 oct. 1998). La commission des droits de la personne du Pakistan (Human Rights Commission of Pakistan - HRCP), faisant état d'un rapport du gouvernement du Pendjab, a affirmé que le tiers environ des 2 500[6]6 madrassas enregistrées du Pendjab donnaient une formation militaire aux élèves et participent directement à des attaques contre d'autres sectes (HRCP 1998, 222; ibid. 1997, 88-89, 173; The Herald oct. 1996, 54). Des sources d'information signalent que de nombreux élèves terminent leurs études à ces écoles religieuses chaque année, et que la plupart d'entre eux possèdent peu de compétences qui leur permettraient de s'intégrer à la société pakistanaise ordinaire (ibid. juin 1994b, 33; ibid. sept. 1998a, 30; AP 12 oct. 1998). Selon le mensuel The Herald de Karachi, les finissants des madrassas [traduction] « constituent un élément crucial des partis religieux extrémistes et forment la majorité des militants de la rue de ces partis » (sept. 1998a, 30). On trouve parmi les fondateurs et les dirigeants de ces groupes sectaires beaucoup qui ont reçu, dans leur jeunesse, des enseignements religieux dans les madrassas, surtout au Pendjab (The News 22 févr. 1997).
Une grande partie de ceux qui appuient les organisations sectaires chiites et sunnites appartiennent aux classes moyennes urbaines et sont souvent des gens de la campagne nouvellement installés en ville (Modern Asian Studies juill. 1998, 705-707, 709). Les organisations sectaires offrent du soutien et de la stabilité aux gens de la classe moyenne qui montent dans l'échelle sociale ainsi qu'à ceux qui veulent faire partie de cette classe, et elles sont particulièrement attirantes pour ceux qui ont l'impression que les institutions politiques traditionnelles ont perdu leur valeur morale (ibid., 708; International Affairs 1997, 329-330). Ces organisations publient d'énormes quantités de documentation sur les sectes et, malgré les coûts de production qui s'élèvent, selon des estimations, à des milliers de roupies par mois, elles distribuent beaucoup de ces documents gratuitement (The Herald juin 1994c, 31). Presque toutes les publications mensuelles et semihebdomadaires des madrassas, des associations religieuses et des organisations sectaires regorgent d'annonces placées par des boutiquiers, des petits commerçants et même quelques entreprises relativement importantes (Modern Asian Studies juill. 1998, 710 n70). Outre l'appui de leurs organisations mères, les groupes activistes armés parrainés par ces organisations reçoivent également une aide financière de [traduction] « protecteurs [...] invisibles » qui sont souvent des groupes extrémistes du Moyen-Orient ou de l'Iran (The Herald juin 1994c, 30; ibid. sept. 1998b, 29; International Affairs 1997, 329-330). Certains groupes recourent également à des moyens de financement comme la contrebande d'armes à feu, les vols à main armée, l'enlèvement de personnes pour en tirer des rançons, la pratique de qabza (capture et occupation de terrains par la force), et des actions terroristes mercenaires (IDSA déc. 1998; The Herald juin 1994c, 30; ibid., juin 1994a, 37). Le journaliste Azhar Abbas, qui rédige des articles sur l'actualité politique dans The Herald, affirme que parmi les hommes armés à l'emploi des groupes sectaires, beaucoup sont, au fond, des tueurs à gages professionnels qui, pourvu qu'on les paye, sont prêts à accomplir des actes criminels tout comme d'autres actes destinés à aider les sectes (26 mai 1999).
Les conflits violents entre les sectes ont leur origine dans les règlements de compte auxquels se livraient au Pendjab, au milieu des années 1980, les dirigeants du parti politique activiste Sipah-e Sahaba Pakistan (SSP, ou gardiens des amis du prophète), formation affiliée au mouvement sunnite deobandi, et ceux du parti politique chiite Tehrik-e Jafria Pakistan (TJP, ou mouvement pour le droit chiite) (The Herald avr. 1998, 41); ils se sont toutefois rapidement étendus à d'autres provinces[7]7 (Jilani 1998, 126-127). Selon des sources d'information, les factions extrémistes des deux partis, soit la Lashkar-e-Jhangvi (LJ, ou armée de Jhangvi) et le groupe Sipah-e-Mohammedi Pakistan (SMP, ou gardiens du prophète), sont responsables de la plupart des meurtres commis au Pakistan dans le cadre des conflits entre les sectes (The Herald avr. 1998, 41; ibid., sept. 1996, 78; Jilani 1998, 126-127; Muslimedia 16-31 mars 1998). Ces meurtres sont presque toujours commis par une équipe de deux agresseurs ou plus, et les victimes sont des membres de la secte rivale (HRCP 1997, 85); on assiste parfois à des affrontements violents entre les sous-sectes sunnites - les deobandis, les barelvis, et l'Ahl-e Hadith (ibid. 1998, 134, 136; Jilani 1998, 126-127). Au début, chaque groupe visait surtout les tueurs à gages de l'adversaire (The Herald août 1997, 37); par la suite, toutefois, ils ont changé de tactique et ont commencé à viser les personnalités (médecins, hommes d'affaires, intellectuels et fonctionnaires) appartenant à l'autre secte (ibid. avr. 1998, 41; HRCP 1997, 85). Plus récemment, ils se sont mis, pour se venger des meurtres commis par leurs adversaires, de tuer sans discrimination les gens appartenant à la secte rivale; par exemple, un groupe peut attaquer une mosquée et, dans l'attaque, toute personne ayant même des liens très vagues avec un groupe rival risque de se faire tuer (ibid., 86-87; The Herald août 1997, 37; ibid. janv. 1999, 101-102).
Les agressions commises par une secte dans une région quelconque du pays peuvent entraîner des représailles ailleurs au pays. Par exemple, le meurtre de trois chiites à Multan (Pendjab) le 30 mars 1998 aurait été provoqué par un affrontement important qui avait eu lieu quelques jours auparavant entre des groupes sectaires à Hangu, dans la Province frontière du nord-ouest, et qui avait fait de nombreux morts et blessés (PPI 30 mars 1998). Azhar Abbas fait remarquer qu'il y a toujours eu des conflits entre les sunnites et les chiites au Pakistan, mais que dans le passé ils se traduisaient le plus souvent par des actions spontanées comme des émeutes, et non par des meurtres visant des victimes choisies ou arbitraires en guise de représailles (26 mai 1999). Les émeutes provoquées par le sectarisme étaient beaucoup plus courantes dans le passé qu'aujourd'hui, selon Abbas, qui ne se rappelle avoir entendu parler d'aucune émeute provoquée par le sectarisme à Karachi au cours des 10 ou 15 dernières années; par contre, c'est pendant cette même période que les meurtres visant des victimes choisies se sont généralisés (ibid.).
Des sources d'information soulignent souvent la nature équivoque des rapports entre les groupes sectaires armés et leurs organisations mères (The Herald juin 1997, 55-56; ibid. août 1997, 37; ibid. oct. 1996, 54; ibid. juin 1994c, 31; The Friday Times 21-27 nov. 1996, 6). Les partis religieux traditionnels minimisent souvent l'importance de leur participation aux conflits entre les sectes, mais des policiers et d'autres observateurs sont persuadés que ces partis ont des [traduction] « liens étroits » avec leurs sous-organisations et groupes scissionnistes, liens qui leur permettent d'exercer une influence sur l'activité de ces derniers (The Herald oct. 1996, 54; ibid. juin 1994c, 31; ibid. août 1997, 37; The Friday Times 21-27 nov. 1996, 6). Il est rare toutefois que les dirigeants des grands partis religieux condamnent les activités violentes de leurs factions armées ou qu'ils exhortent celles-ci à arrêter leurs activités (The Herald oct. 1996a, 54; Modern Asian Studies juill. 1998, 698). Outre l'aval tacite des partis religieux traditionnels, les groupes sectaires activistes peuvent compter sur des réseaux de soutien [traduction] « répandus et bien ancrés » dans la société pakistanaise (The Herald juin 1997, 56; Dawn 3 févr. 1999; The Friday Times 21-27 nov. 1996, 7). Selon un policier de haut rang qui s'est entretenu avec The Herald, [traduction] « beaucoup de gens [...] recueillent de l'information sur la cible avant que [les tueurs à gages] arrivent dans la région. [...] On prend à l'avance les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent se réfugier dans une madrassa et, à partir d'un endroit près de la zone cible, on leur donne des armes et du soutien logistique » (juin 1997, 56). Selon The Herald, ce [traduction] « réseau répandu de complices et de sympathisants [...] constitue la vraie force des mafias sectaires » (ibid.; voir également Modern Asian Studies juill. 1998, 698), et il est [traduction] « pratiquement impossible de le casser » parce que [traduction] « chaque tueur à gages a ses propres contacts et il n'y a aucun membre du groupe qui connaisse tous les autres membres » (The Herald juin 1997, 56).
3. GROUPES CHIÏTES
3.1 Tehrik-e-Jafria Pakistan (TJP)
Le TJP a son origine dans le Tehrik-e Nefaz-e Fiqh-e Jafria (TNFJ, ou mouvement pour l'application du droit chiite), groupe de pression religieux formé en mars 1979 pour lutter contre les politiques d'islamisation du général Zia ul-Haq, qui favorisaient la majorité sunnite du Pakistan (Religion in Politics 1989, 207; Islam and Islamic Groups 1992, 189; JIR janv. 1999, 34; Modern Asian Studies juill. 1998, 693). Le TNFJ avait pour objectif de formuler une constitution islamique basée sur les principes chiites énoncés par l'ayatollah Khomeini de l'Iran, d'unifier la communauté chiite, de protéger les droits des chiites dans un pays à majorité sunnite, et de faire participer activement les chiites à la vie politique du Pakistan (Islam and Islamic Groups 1992, 189; Ahmed 1987, 282). Le TNFJ a adopté [traduction] « un style de politique agressif et contestataire » dans les premières années de son existence (Modern Asian Studies juill. 1998, 697; The Herald juin 1994a, 35-36; Ahmed 1987, 282), surtout après la formation du groupe sunnite SSP au début des années 1980 (The Herald juin 1994a, 35-36). En 1984, le TNFJ s'est scindé en deux groupes, dont un modéré et traditionnel, et l'autre réformateur et activiste (ibid.; Islam and Islamic Groups 1992, 189). Les deux groupes se disaient pro-Khomeini (ibid., 187). En 1987 ou en 1988, le TNFJ s'est rebaptisé Tehrik-e-Jafria Pakistan (TJP) est s'est inscrit comme parti politique (Modern Asian Studies juill. 1998, 697; Religion in Politics 1989, 207; JIR janv. 1999, 34). Le TJP a modéré sa position à la suite de l'assassinat, survenu à Peshawar en août 1988, de son deuxième chef, Allama Arif Al-Hussaini (Modern Asian Studies juill. 1998, 697; The Herald juin 1994c, 29; Islam and Islamic Groups 1992, 189). En réaction à cet assouplissement de la position du TJP, plusieurs membres se seraient séparés de ce parti pour créer leurs propres groupes, et notamment le SMP, faction antisunnite violente (voir la sous-section 3.2) (Modern Asian Studies juill. 1998, 697; FEER 9 mars 1995a, 24). Azhar Abbas déclare lui aussi que s'il n'est pas exclu que le TNFJ ait participé directement à des attaques contre des sectes rivales, le TJP par contre est un parti politique relativement modéré qui s'est intégré à la scène politique traditionnelle (26 mai 1999). Il a précisé qu'on trouve toujours dans les rangs du TJP des activistes qui pourraient, dans des cas isolés, participer à des attaques contre les sectes rivales, mais que le TJP en général ne participent pas à de telles attaques (ibid.).
Le TJP (ou le TNFJ) était la principale organisation politique chiite pendant les années 1980 et une grande partie des années 1990; toutefois, un article récent signale des divisions au sein du parti qui remontent à 1995 ou encore plus loin (The Herald sept. 1998c, 48a). Le Shurae Wahdat-e Islami (conseil de l'unité islamique), organisation cadre chiite créée en 1998, se veut le représentant de tout le mouvement politique chiite militant, rôle qui était déjà revendiqué par le TJP (ibid.). Les groupes affiliés au parti étaient, semble-t-il, de moins en moins contents du style de leadership du chef du TJP Allama Sajid Naqvi, qui était considéré comme le [traduction] « patriarche incontesté du monde politique chiite du Pakistan » (ibid.). Selon The Herald, beaucoup de membres étaient contrariés par l'absence de toute consultation dans le processus de prise de décision et voulaient remplacer l'autocratie par un processus consensuel basé sur la discussion entre les membres (ibid.). En outre, les durs du TJP devenaient de plus en plus mécontents des positions modérées prises par le parti, et les modérés quant à eux trouvaient regrettable que le parti n'arrive pas à freiner la croissance de l'activisme antichiite au Pakistan (ibid.; AFP 12 févr. 1999). Il convient de souligner que les médias ont largement négligé le Shurae Wahdat-e Islami depuis sa création, ce qui pourrait signifier, selon Azhar Abbas, que le conseil n'a jamais réussi à asseoir son autorité (26 mai 1999). Azhar Abbas croyait que le Shurae Wahdat-e Islami existait toujours - une dépêche de l'AFP datée du 12 février 1999 mentionnait que le sénateur Syed Abid Hussain al-Hussaini était son secrétaire général -, mais que pour l'instant le TJP dirigé par Naqvi demeurait le principal véhicule de l'activité politique chiite au Pakistan (ibid.).
Un deuxième événement récent a eu une incidence importante sur le TJP et tous les organisations chiites activistes du Pakistan : en août 1998 les talibans ont défait le Hizb-e Wahdat, parti chiite activiste de l'Afghanistan (The Herald sept. 1998b, 29). Établi dans la région de Hazara en Afghanistan, le Hizb-e Wahdat a des liens étroits avec les groupes chiites du Pakistan (ibid.). Les médias signalent que des milliers de personnes appartenant à l'ethnie hazara, pour la plupart des chiites, ont été massacrées par des combattants talibans appartenant à l'ethnie pachtoune, après la chute en août 1998 de Mazar-e Sharif, ville située dans le nord de l'Afghanistan (The Washington Post 28 nov. 1998; IPS 3 sept. 1998). Selon The Washington Post, les milliers d'Hazaras qui se sont réfugiés dans la ville frontalière de Quetta, au Pakistan, ne pensent qu'à se venger depuis qu'ils ont appris la nouvelle du massacre (28 nov. 1998). Citant des sources dans la police et les services de renseignements pakistanais, l'article affirme que [traduction] « la compassion [des chiites pakistanais] pour leur coreligionnaires tués en Afghanistan est une nouvelle source de motivation dans la lutte entre les sectes » au Pakistan, et [traduction] « [qu']une alliance naturelle [...] se tisse entre les guérilleros hazaras excellemment formées et les groupes [chiites] activistes du Pakistan » (ibid.). Selon un fonctionnaire de la police de Quetta, les Hazaras de Quetta [traduction] « parlent maintenant de vengeance et de règlements de comptes » (ibid.). Il n'y avait pas d'autres renseignements sur cette situation dans les sources consultées par la Direction des recherches.
3.2 Sipah-e-Mohammedi Pakistan (SMP)
La date de la fondation du groupe Sipah-e-Mohammedi Pakistan (SMP, ou gardiens du prophète) est incertaine et varie selon les sources : le groupe a été créé soit en 1990, soit en 1991 (The Herald juin 1997, 57; Modern Asian Studies juill. 1998, 698), soit en 1994 (The Herald déc. 1996, 57; JIR janv. 1999, 35; The Herald juin 1997, 56). Le SMP est un groupe scissionniste du TJP ou, plus précisément, un groupe scissionniste d'un affilié du TJP appelé Imamia Students Organization (ISO)[8]8; celle-ci était [traduction] « devenue trop violente pour survivre » et s'est scindée en plusieurs groupes plus petits, dont le SMP qui a attiré une grande partie des membres les plus activistes de l'ISO (ibid. juin 1994a, 37). Au début, semble-t-il, l'ISO préconisait la ligne dure dans la lutte contre l'extrémisme sunnite (The Daily Telegraph 8 mars 1995); toutefois, vers la fin des années 1980, beaucoup d'activistes de l'ISO s'insurgeaient de plus en plus contre les liens étroits entre l'ISO et les dirigeants du TJP, qu'ils tenaient pour responsables de la croissance rapide du Sipah-e Sahaba Pakistan (The Herald sept. 1998c, 48b-48c; ibid. juin 1994a ,37).
Au début et au milieu des années 1990, le SMP était, semble-t-il, l'un des groupes terroristes les plus violents et les mieux armés du Pendjab (ibid.; JIR janv. 1999, 35). Sous la direction de Ghulam Reza Naqvi et de Murid Abbas Yazdani, tous deux savants à l'Hoza Ilmia de la ville iranienne de Qom[9]9 (The Herald déc. 1996, 57; ibid. juin 1997, 57; Modern Asian Studies juill. 1998, 698 ), le SMP s'est donné pour mandat de [traduction] « supprimer le SSP des manuels d'histoire, et les hommes armés [du SMP] attaquaient les militants du SSP, les membres du clergé sunnite et les bureaux de tout journal qu'ils considéraient comme hostile » (JIR janv. 1999, 35). On soupçonnait également qu'outre ses actions contre les sunnites, le SMP trempait largement dans des activités criminelles, et notamment dans des opérations importantes de contrebande d'armes à feu, pour financer ses activités (The Herald juin 1994a, 37). Comme Reza Naqvi, la plupart des dirigeants du SMP venaient de la campagne ou de petites villes et avaient étudié la religion dans des madrassas au Pendjab, ailleurs au Pakistan ou en Iran; ils avaient reçu une grande partie de leur formation militaire en Afghanistan (Modern Asian Studies juill. 1998, 698). Le SMP, dont le siège se trouve à Thokar Niaz Baig, bastion chiite situé dans la banlieue de Lahore (ibid.; HRCP 1997, 87; The Herald déc. 1996, 55), a affirmé avoir des milliers de partisans au Pakistan ainsi que des bureaux à l'étranger[10]10 (ibid. oct. 1996, 57). Selon une source d'information, le groupe avait des sympathisants influents au sein de la police, des forces armées et des services de sécurité, et notamment dans le service de renseignements Inter-Services Intelligence (ISI) (ibid. août 1997, 38).
Selon des sources d'information, les rapports entre le SMP et le TJP, son organisation mère, étaient plutôt équivoques et ressemblaient aux relations entre le SSP et la Lashkar-e-Jhangvi (voir la section 4.3) (ibid. juin 1997, 56; ibid. juin 1994c, 29; ibid. août 1997, 37). En effet, s'il est un organisme indépendant qui n'est [traduction] « aucunement sous la férule [du TJP] » (ibid. juin 1994c, 29), le SMP a continué d'entretenir des liens avec les dirigeants du TJP et, du moins en public, il a grandement adouci ses critiques concernant l'incapacité du TJP de protéger les chiites contre les activistes sunnites (ibid.; Modern Asian Studies juill. 1998, 698). Pour sa part, le TJP, tout en [traduction] « se tenant à une distance respectueuse » du SMP, s'est abstenu de toute critique explicite et directe des activités violentes du SMP (ibid.; The Herald août 1997, 37).
En septembre 1996, l'ancien chef du SMP Murid Abbas Yazdani a été assassiné à Islamabad (ibid. déc. 1996, 55; ibid. juin 1997, 56). Un activiste du SMP a été arrêté dans cette affaire; sa déclaration que c'était Reza Naqvi qui avait donné l'ordre de tuer Yazdani a provoqué une révolte contre le leadership de Reza Naqvi qui s'est vu obligé de quitter Thokar Niaz Baig et d'entrer dans la clandestinité (ibid. déc. 1996, 55; ibid. juin 1997, 56). La dissension entre Yazdani et Naqvi serait née en 1995, moment où le SMP a adhéré au conseil Milli Yakjehti (Milli Yakjehti Council - MYC) (ibid. déc. 1996, 57); ce comité composé des représentants de 21 organisations religieuses avait été mis sur pied par le gouvernement dans le but de promouvoir les rapports harmonieux entre les sectes au Pendjab (voir la section 6) (HRCP 1997, 88; Jilani 1998, 127-128; The Herald juin 1997, 54). Huit mois de discussions acrimonieuses concernant les modalités d'adhésion au MYC avaient eu pour effet de scinder le SMP en deux factions; celle dirigée par Yazdani a quitté Thokar Niaz Baig pour établir un nouveau bureau à Islamabad, après quoi elle a lancé une campagne contre le groupe de Naqvi (ibid. déc. 1996, 57). De nouveaux dirigeants ont remplacé Yazdani, qui a été assassiné, et Naqvi, qui est entré dans la clandestinité, et les deux factions ont fini par résoudre leurs différends et de fusionner[11]11, mais entretemps la police s'était infiltrée dans le réseau des activistes armés du SMP et avait arrêté 25 des 48 personnes visées (ibid., 56; ibid. juin 1997, 56). Après les arrestations, une grande partie des activistes du SMP qui étaient toujours en liberté, écoeurés par les luttes intestines des dirigeants, sont entrés dans la clandestinité; ne reconnaissant plus de commandement central, ils se seraient dispersés partout au pays afin de reprendre de nouveau leurs activités (ibid.). La concentration de son pouvoir à Thokar Niaz Baig aurait été un des éléments qui ont concouru à la chute du SMP qui se serait également aliéné beaucoup de sympathisants en raison de sa participation confirmée à des activités criminelles (ibid.). Selon The Herald, ni le TJP ni les parrains étrangers n'avaient particulièrement envie de dépanner le SMP (ibid.).
Selon des informations récentes, le SMP, affaibli par des luttes intestines, l'infiltration policière et les attaques du Lashkar-e-Jhangvi, s'est [traduction] « pratiquement désintégré » en 1998 (ibid. janv. 1999, 102; ibid. sept. 1998b, 29; Abbas 3 juin 1999). Ses sources d'assistance à l'étranger, particulièrement en Iran, se sont taries (The Herald sept. 1998b, 29; Abbas 26 mai 1999); ses anciens bienfaiteurs ont conclu, semble-t-il, que la continuation du SMP nuirait à la cause chiite au Pakistan (The Herald sept. 1998b, 29). Malgré ces revers, quelques activistes du SMP poursuivaient encore leur travail (ibid.) et, aux dernières nouvelles, le groupe avait établi son nouveau siège dans l'Imamia Colony de Shahdara, près de Lahore, et commençait à se réorganiser (ibid. janv. 1999, 102). Azhar Abbas croyait en mai 1999 que le SMP était toujours actif; toutefois, Azhar Abbas n'a pas pu donner de précisions concernant les activités du groupe (26 mai 1999). Il a signalé que dernièrement les meurtres de chiites pour des raisons sectaires entraînaient très rapidement les représailles du SMP, ce qui indiquait que ce dernier était toujours un acteur avec lequel il fallait compter[12]12 (ibid.). Il a précisé toutefois qu'à cause des divisions internes du SMP, celui-ci n'était pas capable d'exercer des représailles avec autant de vigueur que son rival sunnite, le SSP; en effet, le SMP était composé, dans le fond, de [traduction] « petits groupements dans diverses villes, sous le commandement d'une autorité centrale très vague et presque inexistante » (ibid. 3 juin 1999). Abbas a ajouté que le SMP était le seul groupe sectaire chiite qui menait des opérations au Pakistan, et qu'il était responsable de presque toutes les attaques lancées contre les sunnites pour des raisons sectaires (ibid. 26 mai 1999). Selon Abbas, les autres groupes de ce genre, si tant est qu'il y en ait, seraient insignifiants (ibid.).
4. GROUPES SUNNITES PRINCIPAUX
4.1 Jamiat-e-Ulema-e-Islam (JUI)
La Jamiat-e-Ulema-e-Islam (JUI, ou conférence des oulémas de l'islam) est un parti religieux de droite fondé en 1945 (Islam and Islamic Groups 1992, 187-188; JIR janv. 1999, 35-36; FEER 9 mars 1995a, 24). Ce parti, qui a des liens avec le mouvement deobandi - mouvement réformateur conservateur indo-musulman -, réclame une révolution islamique et la création d'un État islamique fondé sur l'enseignement sunnite (Islam and Islamic Groups 1992, 188; Current History févr. 1999, 81-82, 85; JIR janv. 1999, 35). Dirigée par Maulana Fazlur Rahman[13]13, la JUI, dont les bastions sont dans les régions pachtounes du Baluchistan et de la Province frontière du nord-ouest (NWFP), a un lien [traduction] « fondamental » avec les talibans de l'Afghanistan : ce sont les madrassas de la JUI qui ont donné aux talibans la plupart de ses dirigeants et militants au début des années 1990 (ibid.; Contemporary Religions 1992, 452; The Herald sept. 1998a, 26; Current History févr. 1999, 85; ibid. avr. 1996, 160). Bien qu'elle soit considérée comme un parti religieux non marginal, la JUI, tout comme la Jamaat-e-Islami (JI) et les autres partis religieux, n'a pas réussi à remporter beaucoup de sièges au parlement (FEER 9 mars 1995a, 24; Muslimedia 16-31 mars 1998).
En décembre 1998, dans les semaines précédant le mois saint de Ramadan, des activistes de la JUI(F) se sont mis à appliquer leur propre version de la charia (loi islamique) à Quetta, ville de quelque 1,2 million d'habitants située près de la frontière afghane (The Herald févr. 1999a, 64). Armés de bâtons, des groupes composés de nombreux activistes de la JUI ont attaqué des magasins de location de vidéos et ont détruit des magnétoscopes et des téléviseurs; étant donné que l'administration locale n'a rien fait pour protéger les propriétaires des magasins, empêcher les agresseurs ou inculper ces derniers, les attaques contre les magasins de location de vidéos sont devenues un fait de tous les jours (ibid.). À Quetta, des observateurs de l'actualité politique ont fait remarquer que la JUI, qui comptait sept députés très influents parmi les 43 députés de l'assemblée provinciale du Baluchistan, aurait pu présenter un projet de loi visant à fermer les magasins de location de vidéos pendant le Ramadan, mais qu'elle a choisi plutôt, à l'instar des talibans, d'employer la force (ibid., 65). La JUI présente un certain intérêt parce qu'elle sert d'inspiration aux talibans et en même temps elle s'inspire elle-même des talibans; en outre, elle revêt une importance certaine parce qu'elle a donné naissance à 11 factions au moins, dont la plus violente serait le SSP (FEER 9 mars 1995a, 24; The Herald juin 1994a, 35).
4.2 Sipah-e Sahaba Pakistan (SSP)
Le Sipah-e Sahaba Pakistan (SSP, ou gardiens des amis du prophète au Pakistan[14]14) a vu le jour en septembre 1984 comme une sous-organisation de la JUI dans le district de Jhang au Pendjab (JIR janv. 1999, 35; The Herald juin 1994a, 35; Modern Asian Studies juill. 1998, 706). Créé dans le but de faire contrepoids aux groupes chiites qui, inspirés par la révolution iranienne, avaient commencé à s'affirmer (Reuter 4 mai 1997; Modern Asian Studies juill. 1998, 704), le SSP aurait été un parti [traduction] « relativement pacifique » tant qu'il demeurait sous l'aile de la JUI; toutefois, le chef du SSP, Maulana Haq Nawaz Jhangvi, qui était président provincial de la JUI, a rompu avec la JUI peu de temps après la fondation du SSP[15]15 (The Herald juin 1994a, 35). Alors que la JUI avait des idées relativement larges concernant le fonctionnement d'un État islamique, le SSP prônait un [traduction] « État purement sunnite dans lequel toutes les autres sectes [seraient] considérées comme des minorités non musulmanes » (ibid.; FEER 9 mars 1995a, 24).
Le SSP a connu une croissance rapide; si dans les années 1980 il était confiné au district de Jhang, en 1994 il était déjà devenu un des plus grands partis religieux du Pendjab, ayant dépassé même la Jamaat-e-Islami (JI) (The Herald juin 1994a, 35). [Traduction] « Parti violemment antichiite » (JIR janv. 1999, 35; Modern Asian Studies juill. 1998, 702), le SSP avait pour objectifs officiels de lutter contre le chiisme sur tous les fronts, de faire en sorte que les chiites soient déclarés une minorité non musulmane au Pakistan, de proscrire les processions dans le cadre de la cérémonie commémorative chiite de Muharram, processions qui, selon lui, étaient une des causes principales des émeutes sectaires, et de faire en sorte que l'islam sunnite soit proclamé la religion d'État du Pakistan (ibid., 701-702; The Herald sept. 1998b, 29). Pour atteindre ces objectifs, le SSP a lancé une guérilla contre les chiites peu de temps après s'être séparé de la JUI, et les organisations activistes chiites ont répliqué en lui rendant la monnaie de sa pièce[16]16 (ibid. juin 1994a, 35; The Friday Times 14-20 août 1998). Jhangvi lui-même a été parmi les premières victimes des méthodes violentes du SSP : il a été assassiné en février 1990; son successeur, Isar al-Haq Qasimi, a lui aussi été, en janvier 1991, la victime d'un assassinat (The Herald juin 1994a, 35; Modern Asian Studies juill. 1998, 705 n53, 707 n60).
Bon nombre de partisans du SSP sont des hommes d'affaires sunnites urbains, dont beaucoup sont des émigrés indiens qui, à l'époque de la partition, se sont installés dans le district de Jhang, où le SSP a vu le jour (ibid., 706). Les associations des marchands locaux du district de Jhang et d'autres centres urbains [traduction] « répondent activement » aux appels du SSP invitant ses partisans à participer à des grèves et à des marches de protestation; celles-ci ont souvent leur point de départ dans les bazars principaux (ibid., 706-707). Le SSP propage également ses idées sectaires dans son organe mensuel officiel, Khilifat-i Rashida (le califat bien orienté), publié à Faisalabad (ibid., 702 n41, 705, 710 n70), ainsi que dans de nombreuses brochures qui reproduisent ce que le parti appelle [traduction] « des éléments inacceptables des livres d'histoire chiites » et qui exhortent le public à se débarrasser des [traduction] « blasphémateurs »[17]17 (The Herald juin 1994c, 31; The Friday Times 21-27 nov. 1996, 7). Selon des sources d'information, les partisans du SSP se trouvent non seulement dans les zones urbaines politisées, mais aussi au Moyen-Orient, où le parti jouit du soutien de plusieurs donateurs riches (Current History avr. 1996, 161; The Herald sept. 1998b, 29); à un certain moment, le gouvernement pakistanais avait affirmé que le financement du SSP venait en grande partie des services de renseignements indiens et irakiens (ibid. juin 1994a, 35). Le SSP entretient également des liens étroits avec les deux factions de la JUI - car ses différends avec la JUI ne porteraient que sur les méthodes à employer, et non sur les croyances (ibid. sept. 1998b, 29) - ainsi qu'avec les talibans, par l'intermédiaire de la JUI et des madrassas de celle-ci (Current History févr. 1999, 85; États-Unis 8 oct. 1998; The Herald sept. 1998b, 29; The Friday Times 14-20 août 1998). Beaucoup d'activistes du SSP ont obtenu leur expérience militaire en Afghanistan, où ils ont fait la guerre aux côtés des talibans (États-Unis 8 oct. 1998; The Friday Times 14-20 août 1998); ils ont reçu leur formation dans des camps en Afghanistan qui étaient, selon toute probabilité, dirigés par le groupe cachemirien activiste Harkat-ul Ansar (HUA) (JIR oct. 1997, 467; The Friday Times 14-20 août 1998; The News International 4 mars 1999; The Herald sept. 1998b, 28; ibid. sept. 1998a, 26). Le parti aurait des sections au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord[18]18 (Modern Asian Studies juill. 1998, 704 n51).
Vers la fin de 1996, The Friday Times a signalé que le SSP avait transféré son siège du district de Jhang au district de Bahawalnagar, situé à la frontière de l'État indien de Rajasthan (21-27 nov. 1996, 7). Ce geste aurait été provoqué par les mesures de répression fréquentes de la police, qui avaient eu pour effet de casser son réseau d'influence dans le district de Jhang; le parti a d'abord essayé de transférer son siège à Faisalabad et, après l'échec de cette tentative, il s'est installé dans le district de Bahawalnagar (ibid.). Selon des sources locales qui se sont entretenues avec The Friday Times, les locaux du siège du SSP se trouvent dans les deux madrassas deobandies les plus importantes du district : la Jamiat-ul Aloom Eidgah à Bahawalnagar et la Dar-ul Aloom Deoband Faqirwali dans la subdivision de Fort Abbas (ibid.). Dans les mois et les années qui précédaient son déménagement, on avait imputé au SSP l'escalade rapide de l'agitation antichiite, des violences et des meurtres de victimes choisies dans le district de Bahawalnagar, phénomènes qui ont souvent débordé les limites du district de Bahawalnagar pour atteindre les districts avoisinants de Bahawalpur, de Vehari et de Kanewal (ibid.). Azhar Abbas a signalé en mai 1999 que le SSP connaissait une croissance rapide dans la province de Sindh depuis deux ans, mais que cette croissance n'avait pas encore entraîné une augmentation correspondante des conflits violents entre les sectes (26 mai 1999).
Plusieurs membres du SSP bien connus, dont des députés des assemblées provinciales et de l'assemblée nationale, ont été accusés d'avoir trempé dans des meurtres commis pour des motifs sectaires (HRCP 1997, 87; The Friday Times 21-27 nov. 1996, 7). Il s'agit notamment de Maulana Tariq Azam - député du SSP représentant le district de Jhang à l'assemblée nationale à l'époque du deuxième gouvernement dirigé par Benazir Bhutto -, qui a été cité dans 10 affaires criminelles, de Maulana Zia-ur Rahman, cité dans 18 affaires criminelles, et de Cheikh Hakim Ali, député à l'assemblée provinciale et ministre, cité dans huit causes (HRCP 1997, 87-88; FEER 9 mars 1995a, 24; The Friday Times 21-27 nov. 1996, 7). Maulana Tariq Azam et Maulana Zia-ur Rahman ont été impliqués dans le meurtre, survenu en novembre 1995, de Shahnawaz Pirzada, chiite influent du district de Bahawalnagar et père de Riaz Pirzada, député du parti du peuple pakistanais (Pakistan People's Party - PPP) au deuxième gouvernement de Benazir Bhutto (The Friday Times 21-27 nov. 1996, 6; Current History avr. 1996, 158). Shahnawaz Pirzada aurait joué un rôle actif dans l'inculpation de plusieurs membres du SSP relativement à des affaires de meurtre (ibid.). Une source d'information a signalé qu'en 1995, le chef du SSP, Azam, qui se déplaçait toujours sous la protection de 40 gardes du corps très bien armés, a déclaré qu'il s'attendait à mourir dans une attaque de motivation sectaire, et qu'il portait partout son linceul (FEER 9 mars 1995a, 24).
Des membres du SSP arrêtés ont avoué également avoir participé à des vols à main armée, dont certains auraient été perpétrés [traduction] « en collaboration avec des éléments du Mouvement Qaumi Mojahir (MQM) », parti ethnopolitique de Karachi impliqué dans une grande partie de la violence dans les régions urbaines du Sindh[19]19 (HRCP 1997, 87; The Age 27 mars 1995). Selon une source d'information, des fonctionnaires ayant des liens étroits avec la police de Karachi ont déclaré en 1995 que la faction Haqiqi du MQM (MQM-H) avait 500 hommes armés qui cherchaient du travail après avoir été délaissés par un service de renseignements; la faction s'est donc alliée au SSP (ibid.). La stratégie du MQM-H, selon The Age, c'était d'essayer de scinder le groupe rival non sectaire MQM-Altaf (MQM-A) en factions sunnite et chiite, objectif que le SSP appuyait (ibid.). Azhar Abbas a affirmé en mai 1999 qu'il n'y avait plus de liens connus entre des groupes sectaires violents et l'une ou l'autre faction du MQM (26 mai 1999). L'alliance formée en 1995 entre le SSP et le MQM-H était, selon Abbas, temporaire et liée à la situation spéciale de cette époque-là; Abbas a ajouté que les groupes chiites ont réagi en formant une alliance temporaire avec la faction Altaf du MQM (ibid.).
Le SSP a également donné naissance à de nombreux groupes scissionnistes (The Herald juin 1994c, 29; Choudary 29 mai 1999). Selon un rapport préparé en janvier 1994 par un service spécial de la police du Pendjab, beaucoup de ces groupes ressemblaient [traduction] « plus à des mafias personnelles de féodaux influents, dirigées par des maulvis locaux, qu'à des organisations au sens propre de ce mot » (The Herald juin 1994c, 29). Un policier qui s'est entretenu avec The Herald a déclaré que beaucoup de ces groupes scissionnistes [traduction] « étaient composés de voyous qui cherchaient à occulter leurs activités criminelles » (ibid.); d'autres sources d'information corroborent cette description (Choudary 29 mai 1999; The Friday Times 21-27 nov. 1996, 7; Muslimedia 16-31 mars 1998). Bien que tous ces groupes soient antichiites, ils ne sont pas, selon The Herald, des organisations cohérentes ayant des objectifs bien définis, et ils ne peuvent pas expliquer en quoi ils diffèrent l'un de l'autre (juin 1994c, 29). Au moins cinq des groupes scissionnistes du SSP sont toutefois assez importants (ibid.) et, de ce fait, font l'objet d'une analyse dans le présent exposé.
4.3 Lashkar-e-Jhangvi (LJ) et Harkat-ul Ansar (HUA)
La Lashkar-e-Jhangvi (LJ, ou armée de Jhangvi), appelée ainsi en souvenir de Maulana Haq Nawaz Jhangvi, chef assassiné du SSP, a été formée en 1995 ou en 1996 par des éléments radicaux du SSP qui ont laissé ce parti parce que ses dirigeants ont établi un dialogue avec les chefs d'organisations chiites activistes (voir la section 6) (JIR janv. 1999, 35; The Herald juin 1997, 55; AFP 6 avr. 1999a). Ce groupe vague de scissionnistes du SSP a alors créé la LJ sous la direction de Riaz Basra, qui a fait parler d'elle pour la première fois après le meurtre, survenu en 1990, d'un diplomate iranien à Lahore (HRCP 1997, 88; The Herald juin 1997, 55; AFP 6 avr. 1999a; ibid. 6 avr. 1999b). La LJ dirigée par Basra est devenue depuis quelques années [traduction] « l'une des plus redoutables » organisations sectaires activistes du Pakistan (The Herald sept. 1998b, 29; voir également The Daily Star 7 avr. 1999). La LJ, que ses membres considèrent comme une organisation du jihad, mène ses opérations surtout à l'intérieur du Pakistan, où elle a réclamé la responsabilité d'un grand nombre de massacres de chiites et de meurtres de victimes choisies parmi les dirigeants chiites communautaires et religieux (JIR janv. 1999, 35; The Herald sept. 1998b, 29; HRCP 1997, 88; The News International 4 mars 1999); parfois, les victimes ont même été des responsables sunnites (The Herald juin 1997, 55). En outre, le groupe a lancé de nombreuses attaques contre des citoyens iraniens et des intérêts iraniens au Pakistan (AFP 22 févr. 1998; DPA 12 janv. 1998; ibid. 21 févr. 1998; HRCP 1998, 137), et on l'a impliqué dans l'attentat, fait à Lahore le 3 janvier 1999, contre la vie du premier ministre Nawaz Sharif (The News International 4 mars 1999; The Daily Star 7 avr. 1999; AFP 6 avr. 1999b; ibid. 6 avr. 1999a). La LJ serait le seul groupe sectaire activiste à appeler les journaux pour revendiquer ses attaques (The Herald oct. 1997, 53; ibid. févr. 1998a, 46). Les actions du groupe et les raisons de ses attaques sont souvent décrites dans son magazine de langue ourdoue Inteqame Haq (juste vengeance), publié, semble-t-il, à l'intention des dirigeants du gouvernement, des hauts fonctionnaires et des cadres supérieurs de la police (ibid. oct. 1997, 53).
Des articles parus dans The Herald signalent que la police éprouve beaucoup plus de difficulté à s'infiltrer dans la LJ que dans le SMP (ibid. sept. 1998d, 18; ibid. oct. 1997, 53; ibid. juin 1997, 55). Cette difficulté découle d'une part de la nature ambiguë des rapports entre la LJ et le SSP (ibid.), et d'autre part de la structure organisationnelle de la LJ (ibid. sept. 1998d, 18; ibid. oct. 1997, 53). En public, les dirigeants du SSP soutiennent qu'il n'existe plus de liens entre les deux groupes et que le SSP ne participe aucunement aux activités de la LJ (ibid. juin 1997, 55; AFP 6 avr. 1999a; ibid. 6 avr. 1999b; The Herald juin 1994c, 31). Toutefois, The Herald fait remarquer que les deux organisations se complètent très bien (ibid. juin 1997, 55; ibid. juin 1994c, 31) : la LJ allège le fardeau du SSP en menant des attaques que celui-ci ne pourrait pas exécuter lui-même en raison des risques trop élevés sur le plan politique (ibid. juin 1997, 55; ibid. juin 1994c, 31), et elle se charge aussi de venger le meurtre de membres du SSP (ibid. juin 1997, 55). S'il se peut bien que la LJ ne soit pas sous les ordres directs des dirigeants du SSP, selon The Herald, [traduction] « il n'y a aucun doute qu'elle remplit la mission de Maulana Jhangvi [...] À part les activités politiques très en vue de la Sipahe Sahaba, il y a peu de choses qui distinguent les deux organisations l'une de l'autre » (ibid.; voir également ibid. mai 1999a, 48). Toujours selon The Herald, la décentralisation de la structure de commandement et le fait que le SSP peut sans difficulté désavouer les actions terroristes sont devenus un [traduction] « cauchemar » pour les organismes chargés de l'application de la loi (ibid. juin 1997, 55).
La Lashkar-e-Jhangvi est divisée en petites cellules; chacune comprend entre cinq et huit activistes et fonctionne indépendamment des autres cellules (ibid. sept. 1998d, 18; ibid. oct. 1997, 53; Dawn 3 févr. 1999). Les activistes de chaque cellule ne savent pas, semble-t-il, combien d'autres cellules il y a dans l'ensemble du Pendjab (The Herald sept. 1998d, 18), ni la nature des opérations futures (ibid. oct. 1997, 53). Les activistes disposent de téléphones cellulaires pour communiquer au besoin avec d'autres cellules (ibid.). Après avoir mené une attaque, les activistes de la LJ doivent se débrouiller par eux-mêmes (ibid.); souvent, ils se dispersent pour ensuite se réunir à un des camps de l'HUA en Afghanistan afin de préparer leurs prochaines opérations (The News International 4 mars 1999).
Selon une source d'information, les succès même que remportent de temps à autre les organismes chargés de l'application de la loi dans leur lutte contre la LJ ont pour effet de compliquer parfois leur tâche. Ainsi, selon The Herald, l'arrestation de plusieurs activistes du SSP et de la LJ après le massacre perpétré le 11 janvier 1998 au cimetière de Mominpura, dont il a été question plus tôt dans le présent exposé, a eu deux conséquences imprévues : primo, les autres activistes connus - Riaz Basra, Akram Lahori et d'autres - sont entrés dans une clandestinité totale et, au lieu de s'exposer à la capture en menant eux-mêmes des attaques, ils se sont consacrés à former des recrues et à diriger les opérations; secundo, cette formation à permis à un nouveau groupe de jeunes hommes de devenir des activistes et de remplacer ceux qui avaient été arrêtés (sept. 1998d, 18). The Herald a appris de source policière que beaucoup de ces activistes étaient âgés entre 16 et 20 ans et étaient très bien formés (ibid.). Puisque ces jeunes activistes ont généralement un casier judiciaire vierge, il est difficile de les repérer et de les arrêter; en outre, ils ne s'intéressent généralement pas beaucoup au fonctionnement de l'organisation et ne font qu'obéir aux ordres de leurs commandants (ibid.). Des sources d'information signalent que la LJ a des liens étroits avec le groupe activiste cachemirien Harkat-ul Ansar (HUA) (ibid.; The Herald sept. 1998b, 29; voir également JIR oct.1997, 467) et que beaucoup d'activistes clés de la LJ ont reçu leur formation militaire dans des camps de l'HUA en Afghanistan (The News International 4 mars 1999). Un rapport confidentiel présenté au gouvernement du Pakistan par un service de renseignements, dont The News International a obtenu copie, affirme qu'au début de 1999, 800 Pakistanais, dont la plupart avaient des liens avec le SSP ou la LJ, recevaient de la formation en Afghanistan au camp Khalid Bin Waleed, organisé par l'HUA (ibid.). En général, selon le rapport, la formation [traduction] « dure de quatre à huit semaines au cours desquelles les participants apprennent en long et en large comment se servir d'armes légères sophistiquées, [...] préparer et manipuler des dispositifs explosifs de fortune et des explosifs, [et] [...] exécuter des raids éclairs » (ibid.). Le rapport impute le massacre du 11 janvier 1998, perpétré au cimetière de Mominpura, ainsi que l'attentat du 3 janvier 1999 contre la vie du premier ministre Sharif, à des activistes de la LJ formés par l'HUA (ibid.). Au moment de la rédaction de ce rapport présenté par un service de renseignements, Riaz Basra et plusieurs autres dirigeants de la LJ s'étaient déjà réfugiés dans des camps de l'HUA en Afghanistan (ibid.).
Des informations récentes indiquent que les organismes chargés de l'application de la loi sont peut-être en train de prendre le dessus dans leur lutte contre la LJ (voir également la section 6). The News International a signalé que le 16 novembre 1998, la police a arrêté Mazhar-ul Haq, qui serait le [traduction] « bras droit » de Riaz Basra, ainsi que 12 autres activistes de la LJ de Bhera, de Gujrat et de Bahauddin (ibid. 17 nov. 1998). Le 5 avril 1999, Basra lui-même aurait trouvé la mort dans un échange de coups de feu avec la police à Sargodha (Pendjab) (The Daily Star 7 avr. 1999; AFP 6 avr. 1999a; Dawn 6 avr. 1999b), mais le gouvernement du Pendjab a par la suite démenti cette information (AFP 6 avr. 1999b; Xinhua 6 avr. 1999; Radio Pakistan 7 avr. 1999). Le 14 avril 1999, quatre hommes armés de la LJ ont perdu la vie à Langharwal - endroit situé sur la principale route de Jhang à quelque 35 kilomètres de Chiniot - à la suite d'un affrontement armé de cinq heures avec des unités d'élite spéciales (The Herald mai 1999b, 49). Au nombre des quatre activistes tués figuraient Ejaz Ahmed Tara (alias Jajji) - le numéro deux de la LJ - et Tariq Virk, qui était, semble-t-il, le spécialiste le plus chevronné de la LJ en matière d'explosifs (ibid.). Jajji and Virk avaient été impliqués dans plusieurs meurtres importants au Pendjab qui étaient liés à la lutte entre les sectes; il s'agit notamment de l'assassinat de Ghulam Sawag, député à l'assemblée provinciale (ibid.). Les quatre activistes auraient été capturés par la police à la suite de l'échec de la tentative qu'ils avaient faite pour enlever un membre riche de la communauté qadianie de Rabwah (ibid.).
5. AUTRES GROUPES SECTAIRES SUNNITES
Le SSP, le SMP et la LJ sont responsables de la majorité écrasante des actions violentes liées à la lutte entre les sectes au Pakistan, mais il existe également plusieurs groupes plus petits et moins connus. Dans les sous-sections suivantes, il sera question de trois de ces groupes : le Sunni Tehrik, le Tehrik-e-Nifaz-e-Shariat-e-Mohammadi et le Tehrik-e-Tulaba.
5.1 Sunni Tehrik
On dispose de peu d'informations sur le Sunni Tehrik (mouvement sunnite). The Herald signale qu'à l'origine, au début des années 1990, il était un groupe scissionniste de la Jamiat-e-Ulema-e-Pakistan (JUP) (association des oulémas du Pakistan) (ibid. juin 1994c, 29; ibid. juin 1994a, 36-37). Parti politique fondamentaliste créé en 1948 par des mollahs gauchisants, la JUP prône l'établissement d'un État islamique fondé sur les principes islamiques sunnites (Islam and Islamic Groups 1992, 188; Political Parties of the World 1988, 413; Political Parties of Asia and the Pacific 1985, 904). Elle représente le mouvement barelvi au sein de l'islam pakistanais (Contemporary Religions 1992, 452; IDSA déc. 1998; Abbas 26 mai 1999), et elle est particulièrement forte dans les petites villes et les régions rurales du Pendjab (Contemporary Religions 1992, 452). Les barelvis, qui constituent le plus grand courant sunnite au Pakistan (ibid.), se considéreraient comme membres de la sawad-e azam (grande majorité) et [traduction] « ne considèrent par les chiites comme des musulmans » (Ahmed 1987, 283). Toutefois, selon Azhar Abbas, la JUP est un parti politique intégré à la scène politique traditionnelle et n'a pas de liens directs avec des groupes sectaires violents (26 mai 1999).
Il existe beaucoup de [traduction] « factions » barelvies au Pakistan, mais le seul groupe barelvi violent connu est le Sunni Tehrik (ibid.). Selon une source d'information consultée en mai 1999, le groupe était dirigé par Maulana Tahir Qadri (Choudary 29 mai 1999). Le Sunni Tehrik aurait connu une croissance très rapide en 1993 et en 1994 dans les districts de Faisalabad et de Jhang (The Herald juin 1994a, 36-37). La plupart de ses membres étaient, semble-t-il, d'anciens membres de la JUP qui s'étaient désillusionnés et des étudiants d'un énorme réseau de madrassas barelvies appelé Zia-ul Quran, où [traduction] « les seuls sujets de discussion sont les différences entre les deobandis et les barelvis » (ibid. juin 1994c, 29; ibid. juin 1994a, 36-37). Outre son antichiisme (ibid. juin 1994c, 29), on connaît peu de choses sur les objectifs du Sunni Tehrik (ibid. juin 1994a, 36-37). En 1994, The Herald a signalé qu'on soupçonnait certains dirigeants du groupe de tremper dans des activités criminelles - et notamment dans des vols à main armée de grande envergure à Faisalabad, à Gujranwala, à Sargodha et à Sialkot - et d'être les hommes de main de petits propriétaires fonciers locaux (ibid.). Au début d'avril 1999, un ancien chef d'unité du MQM a été impliqué dans le meurtre d'un activiste du Sunni Tehrik à Karachi (Dawn 3 avr. 1999). Selon Azhar Abbas, on aurait également signalé des affrontements violents qui auraient récemment eu lieu entre le Sunni Tehrik et les activistes du SSP et de la LJ, affrontements qui s'inscrivent, selon toute probabilité, dans le cadre d'une lutte pour des territoires (26 mai 1999).
5.2 Tehrik-e-Nifaz-e-Shariat-e-Mohammadi (TNSM)
Le Tehrik-e-Nifaz-e-Shariat-e-Mohammadi (TNSM, ou mouvement pour la défense de la loi du prophète) est un parti wahabiste d'activistes tribaux qui a commencé à faire parler de lui pour la première fois en 1994, époque où il a mené une révolte armée pour réclamer l'application de la charia dans la division de Malakand, située dans la Province frontière du nord-ouest (JIR janv. 1999, 36; The Herald févr. 1999b, 59; Extremist Groups 1996, 1091). L'appel aux armes lancé par le groupe a attiré de nombreux combattants afghans des régions avoisinantes de Peshawar, de Mohmand et de Bajaur, et la situation [traduction] « est rapidement devenue anarchique » (The Herald févr. 1999b, 59). Au moins 40 personnes, dont un député du PPP à l'assemblée nationale et plus de 12 paramilitaires, ont perdu la vie dans les combats avant que le gouvernement Sherpao ne réussisse, au bout d'une semaine, à rétablir l'ordre (ibid.). En 1995, des affrontements à propos de terrains ont coûté la vie à huit activistes du TNSM et à un policier à Swat, dans la Province frontière du nord-ouest (Extremist Groups 1996, 1091). Selon The Herald, certains observateurs signalent que près de la moitié des membres du groupe pourraient être des criminels (févr. 1999b, 59).
Dirigé par Sufi Mohammed, le TNSM mène ses activités surtout dans les zones habitées par des tribus - notamment dans la région de Swat et dans les districts avoisinants de la Province frontière du nord-ouest - et réclame l'application de la charia (Dawn 6 avr. 1999a; Extremist Groups 1996, 1091; Choudary 29 mai 1999). Dans un discours prononcé en août 1998 devant des milliers de partisans à Peshawar, Sufi Mohammed aurait déclaré que les opposants à l'application de la charia étaient des wajib-ul-qatl (des gens qui méritaient la mort) (JIR janv. 1999, 36). Bien enraciné dans la Province frontière du nord-ouest, le TNSM n'a toutefois pas vraiment réussi à étendre son champ d'action au-delà des zones tribales de la province (Abbas 26 mai 1999). Selon Azhar Abbas, le TNSM est en train de consolider ses positions dans la Province frontière du nord-ouest et ne semble pas attiré par des possibilités d'expansion (ibid.). Le professeur Choudary précise que le gouvernement de Mehtab Abbasi actuellement au pouvoir dans la Province frontière du nord-ouest semble préférer collaborer avec le TNSP plutôt que de suivre une politique d'affrontement (29 mai 1999; The Herald février 1999b, 60). En effet, selon des sources d'information, le gouvernement a récemment fait des concessions en ce qui concerne l'application de la charia dans la région (ibid., 59; Choudary 29 mai 1999). On ne dispose pas encore des détails de ce rebondissement mais, semble-t-il, Sufi Mohammed appuie maintenant le gouvernement (ibid.).
5.3 Tehrik-e-Tulaba
Le mouvement étudiant Tehrik-e-Tulaba (mouvement des étudiants), comme le TNSM, est une organisation inspirée par les talibans qui cherche à imposer la charia au Pakistan (ibid.; The Herald févr. 1999b, 60). Le groupe a été créé dans l'Orakzai Agency, une région tribale administrée par le gouvernement fédéral, et jusqu'à présent il n'a pas mené d'action au-delà des limites de cette région (Choudary 29 mai 1999; The Herald févr. 1999b, 60; Country Reports 1998 1999, section 1c). Le 13 décembre 1998, un tribunal de la charia mis sur pied par le groupe a mis à l'amende six personnes accusées d'être complices d'un meurtre et, à titre de punition supplémentaire, il a fait incendier leurs maisons (ibid.); le meurtrier quant à lui a été exécuté en public la même journée (ibid., section 1e).
5.4 Groupes jihadiques
Même si le sujet dépasse les limites du présent exposé, il convient de rappeler ici l'existence de plusieurs organisations jihadiques pakistanaises qui mènent des opérations en Afghanistan et au Cachemire. Les trois groupes principaux de ce genre sont l'Harkat-ul Ansar (HUA), l'Hizb-ul Mujahideen et la Lashkar-e-Taiba (Indian Express 31 déc. 1998; The Daily Star 28 mai 1999); selon une source d'information, il y a peut-être une douzaine de groupes de ce genre, ou encore plus, au seul Cachemire (JIR oct. 1997, 466). Le gouvernement du Pakistan se déclare contre le [traduction] « terrorisme » et soutient qu'il ne fournit ni formation ni armes aux activistes sectaires qui mènent des luttes au Cachemire (Patterns of Global Terrorism: 1998 1999); la plupart des sources d'information s'accordent toutefois pour dire que le gouvernement pakistanais offre à ces groupes un soutien politique, diplomatique et moral (ibid.; Indian Express 31 déc. 1998; JIR oct. 1997, 466-468; The Herald sept. 1998e, 55; ibid. sept. 1998b, 28). Pour ce qui est de la nature et de la solidité des liens entre les organisations jihadiques et les groupes sectaires activistes qui mènent leurs opérations à l'intérieur du Pakistan, les sources d'information consultées expriment des avis divergents. Ainsi, Azhar Abbas croit que tout lien serait indirect, et revêtirait la forme d'un soutien moral accordé aux organisations appartenant au même courant de l'islam (26 mai 1999), alors que d'autres sources signalent que les organisations jihadiques ont des liens étroits avec des groupes sectaires violents au Pakistan, et notamment avec la LJ et le SSP, ainsi qu'avec de grands partis sunnites comme la JI et la JUI (The Herald nov.-déc. 1998b, 53; JIR oct. 1997, 467; ibid. janv. 1999, 35; Choudary 29 mai 1999). Les organisations jihadiques, en cherchant du financement et en recrutant des volontaires au Pakistan (Patterns of Global Terrorism: 1998 1999; The Herald sept. 1998b, 28; The Globe and Mail 20 août 1998; JIR oct. 1997, 467), contribuent pour le moins, selon une source d'information, [traduction] « à créer un terrain propice aux opérations des groupes activistes et terroristes au Pakistan » (Patterns of Global Terrorism: 1998 1999). Au début de 1998, The Herald a signalé que les organisations jihadiques [traduction] « ont déjà commencé à faire la guerre contre [...] la kufr (apostasie) et le shirk (polythéisme) chez nous » (janv. 1998, 130); dans un autre article, il avait déjà signalé que des activistes avaient été rappelés de l'Afghanistan pour qu'ils puissent mener des opérations au Pakistan (ibid. nov.-déc. 1998b, 52).
6. RÉACTION DE L'ÉTAT
Les sources d'informations s'entendent pour dire que la réaction de l'État aux groupes sectaires et aux violences engendrées par le sectarisme a été intermittente, incohérente et souvent décousue (FEER 9 mars 1995a, 24; Current History avr. 1996, 160-161; Jilani 1998, 127; The Herald oct. 1996, 56; ibid. janv. 1999, 102). Les mesures prises par le gouvernement pour résoudre le problème des sectes ont souvent eu pour objectif de réagir aux crises plutôt que de les prévenir (HRCP 1997, 89); les quelques mesures législatives qui devaient freiner les conflits violents entre les sectes n'ont pas produit les résultats escomptés[20]20 (Jilani 1998, 127; The Herald janv. 1999, 101; HRCP 1997, 89; ibid. 1998, 34-36). Selon des informations publiées par The Herald et la commission des droits de la personne du Pakistan (HRCP), les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas pris de mesures efficaces pour empêcher les jeunes de se joindre aux groupes sectaires, n'ont pas sévi contre les milliers de madrassas qui prêchent la haine sectaire et n'ont pas élaboré de politiques cohérentes pour gérer les problèmes causés par les divisions entre les sectes ou pour augmenter la tolérance en matière de religion (The Herald janv. 1999, 102; HRCP 1997, 89). Des sources d'information affirment que les gouvernements ont été intimidés par l'activisme des groupes religieux intégristes et de leurs groupes scissionnistes violents (Jilani 1998, 127; HRCP 1997, 89-90; The Friday Times 21-27 nov. 1996, 7); quand des activistes sectaires ont été arrêtés, ils ont souvent pu acheter leur liberté moyennant de petits pots-de-vin, et la police et les autorités carcérales leur ont souvent accordé un traitement préférentiel (The Herald sept. 1996, 78; ibid. févr. 1998a, 47; ibid. nov.-déc. 1998b, 50; The Friday Times 21-27 nov. 1996, 7). L'incohérence des politiques gouvernementales, selon The Herald, se manifeste même au niveau de l'administration des districts, où des commissaires adjoints et des surintendants de police ont parfois fait des pieds et des mains pour combler les besoins des dirigeants des groupes sectaires activistes, notamment en les traitant comme des personnalités de marque et en leur donnant une escorte policière (oct. 1996, 56). Dans les cas où la police a sérieusement essayé d'attraper des criminels sectaires, elle n'a souvent pas pu compter sur l'appui des fonctionnaires et des politiciens (ibid. juin 1997, 57). Un policier du district de Bahawalpur a raconté au journal The Friday Times vers la fin de 1996 que sans obtenir préalablement [traduction] « l'approbation des autorités du plus haut niveau », la police ne pouvait pas arrêter des personnalités soupçonnées d'avoir participé à des meurtres motivés par le sectarisme (21-27 nov. 1996, 7).
Pendant qu'il était au pouvoir, le gouvernement de Bhutto a [traduction] « ménagé » le SSP, parce qu'il avait besoin de l'appui de ce groupe à l'assemblée provinciale du Pendjab (Current History avr. 1996, 161); le gouvernement a même nommé au cabinet des ministres un député du SSP qui siégeait à l'assemblée provinciale[21]21 (The Herald oct. 1996, 56). Souvent, les mesures prises par le gouvernement contre le sectarisme entrent en conflit avec ses politiques en matière de sécurité nationale. Un rapport publié le 15 octobre 1998 par l'organisation parisienne Observatoire géopolitique des drogues (OGD) qualifie le Pakistan de [traduction] « narco-État » où [traduction] « trafiquants de drogue, politiciens, haut fonctionnaires et membres des forces armées sont embrouillés dans un entrelacement complexe d'activités liées aux narcotiques » (Dawn 16 oct. 1998); le rapport affirme en outre que les services pakistanais de renseignements, et particulièrement l'Inter-Services Intelligence (ISI), se servent depuis longtemps des profits du narcotrafic pour financer le travail de groupes activistes armés en Afghanistan et au Cachemire (ibid.). L'analyste Anthony Davis a fait remarquer l'incohérence des politiques pakistanaises en matière de sécurité : [traduction] « de jeunes fanatiques recherchés par la police au Pakistan à cause de leur participation à des violences sectaires trouvent asile auprès de mouvements étrangers appuyés par les services de renseignements du Pakistan » (Asiaweek 8 janv. 1999).
Une source d'information invoque ce qu'elle appelle la [traduction] « doctrine du sentiment religieux offensé » pour expliquer l'absence de politiques gouvernementales cohérentes destinées à freiner les conflits violents entre les sectes (The Herald févr. 1998b, 49). Ainsi, selon The Herald, l'explosion des conflits violents entre les sectes
[traduction] découle du fait que l'État accepte le sectarisme et les conflits violents entre les sectes comme un mode de vie et une façon raisonnable d'exprimer le mécontentement. Le problème se trouve dans une certaine manière de penser selon laquelle les sentiments religieux offensés sont plus sacrés que le droit à une vie civile bien ordonnée. Cette mentalité est renforcée par chaque nouvelle mesure que le gouvernement prend pour circonscrire les conflits violents entre les sectes (ibid., 50).
Une de ces mesures était la création par le gouvernement, au début de 1995, du Milli Yakjehti Council (MYC, ou conseil de la solidarité nationale), dans le but d'ouvrir un dialogue entre 21 groupes sectaires et partis religieux (HRCP 1997, 88; Jilani 1998, 128; The Herald oct. 1996, 53). Le conseil devait aider le gouvernement du Pendjab à trouver un moyen de mettre fin aux luttes entre les sectes et à permettre aux partis religieux de redorer leur blason après des années de surenchère de violence (HRCP 1997, 88; Jilani 1998, 128; The Herald oct. 1996, 53). Le gouvernement n'a pas tardé à proclamer la fin des conflits violents entre les sectes au Pakistan, mais le MYC a fini par se révéler peu efficace (HRCP 1997, 88; Jilani 1998, 128; The Herald oct. 1996, 53). Le SMP et le SSP, qui voyaient dans le code de déontologie proposé par le conseil un conflit avec des principes fondamentaux de leur foi, ont été les premiers à se retirer du conseil; dès l'automne de 1995, le MYC était en cours de désagrégation (Jilani 1998, 128; The Herald oct. 1996, 53). Immédiatement avant la formation du conseil, le gouvernement avait sévi contre les groupes sectaires : il avait arrêté plus de 200 activistes des partis religieux et avait élaboré des mesures visant à limiter la croissance des madrassas (ibid.). Toutefois, après la formation du MYC, le gouvernement a abandonné ces mesures, et le conseil, dont les membres ne voyaient plus de menace, s'est désintégré[22]22 (ibid.). Selon The Herald, tous les conseils de paix de ce genre, les réunions au sommet et les tractations juridiques depuis plus de dix ans n'ont pratiquement rien donné de concret (ibid. nov.-déc. 1998b, 50); tout au plus, ils ont servi peut-être à augmenter la crédibilité politique des dirigeants des organisations sectaires (ibid. juin 1997, 54).
En août 1997, le gouvernement de Nawaz Sharif de la ligue musulmane du Pakistan (Pakistan Muslim League - PML) a adopté la loi sur la répression du terrorisme (Anti-Terrorism Act - ATA) (HRCP 1998, 34; AI 1998), destinée à empêcher [traduction] « le terrorisme [et] les conflits violents entre les sectes et [à assurer][...] des procès rapides » (HRCP 1998, 34; AI 1998). Toutefois, avocats, politiciens, défenseurs des droits de la personne, organisations internationales de défense des droits de la personne et simples citoyens ont tous critiqué [traduction] « ses dispositions sévères, le fait qu'elle légalisait la perpétration d'exécutions extrajudiciaires par la police, et la création d'un système judiciaire parallèle » (HRCP 1998, 36; Current History déc. 1997, 424; AI 1998). La loi conférait à la police des pouvoirs considérables lui permettant d'employer une force meurtrière contre toute personne qui [traduction] « est en train de commettre ou que l'on croit être sur le point de commettre un crime terroriste »; elle prévoyait également la création de tribunaux antiterroristes spéciaux chargés de juger les personnes inculpées de crimes terroristes (ibid.; HRW 1998, 2; Country Reports 1998 1999, section 1e). Les procès dans ces tribunaux - qui n'offraient pas les garanties juridiques des cours ordinaires - ne pouvaient pas durer plus de sept jours, et aucun recours à des instances supérieures n'était possible (AI 1998; HRCP 1998, 35-36; HRW 1998). Des pétitions présentées en justice mettaient en question la constitutionnalité de ces tribunaux, et en mai 1998, la cour suprême a déclaré que la loi était inconstitutionnelle et a ordonné au gouvernement de la modifier (Country Reports 1998 1999, sections 1c et 1e; HRW 1998).
Des informations récentes indiquent que le gouvernement a commencé à appliquer une politique beaucoup plus sévère en matière d'activisme sectaire, en employant les mêmes méthodes qu'il avait employées en 1995 pour freiner la violence ethnopolitique à Karachi (The Herald nov.-déc. 1998b, 50; ibid. nov.-déc. 1998a, 54; ibid. janv. 1999, 102; JIR mars 1999, 6). Vers septembre 1998, selon The Herald, l'attitude de la police du Pendjab [traduction] « semble avoir subi une transformation dramatique » (nov.-déc. 1998a, 54; ibid. nov.-déc. 1998b, 50). Partout dans la province, la police a commencé à effectuer des raids à grande échelle contre les activistes sectaires, et surtout contre ceux qui appartenaient au SSP et à la Lashkar-e-Jhangvi (ibid. nov.-déc. 1998a, 54; ibid. nov.-déc. 1998b, 50; JIR mars 1999, 6; Country Reports 1998 1999, section 1d; AP 4 avr. 1999); certains détenus auraient été [traduction] « torturés » et tués dans de faux affrontements (The Herald nov.-déc. 1998a, 54; ibid. nov.-déc. 1998b, 50; Dawn 26 déc. 1998). Le gouvernement a changé de politique parce qu'il se serait senti de plus en plus frustré par les tribunaux et par l'échec des mesures législatives comme la loi sur la répression du terrorisme (ATA) (The Herald nov.-déc. 1998b, 50-51), et aussi parce que l'accord tacite entre la police et les activistes - accord voulant que le personnel des services chargés de l'application de la loi soit épargné par les sectaires pourvu que ces services ne mènent pas d'enquête sérieuse sur les activités des organisations sectaires - aurait été violé (ibid. nov.-déc. 1998a, 54; ibid. nov.-déc. 1998b, 50). Faisant état de renseignements obtenus de sources [traduction] « dans la place », The Herald a signalé que dès le mois de mai 1997, le premier ministre du Pendjab, Shabaz Sharif, avait sommé les activistes sectaires de [traduction] « s'amender [...] sous peine d'une répression sévère » (ibid.). La haute cour de Lahore et la cour suprême ont toutes deux trouvé inconstitutionnelles certaines dispositions de la loi sur la répression du terrorisme (ATA) (Country Reports 1998 1999, section 1e). L'échec des tribunaux antiterroristes - qui n'ont pu condamner que quelques personnes avant que la haute cour de Lahore et la cour suprême ne mettent fin à leurs activités (ibid.) - et l'augmentation des menaces et des attaques lancées contre des cadres policiers par les activistes sectaires au cours de l'été de 1998 auraient eu pour effet de persuader les fonctionnaires policiers et gouvernementaux qu'une opération comme celle menée par le général Babar[23]23 était le seul moyen d'en finir définitivement avec la violence dans les conflits entre les sectes (The Herald nov.-déc. 1998b, 50-51; ibid. nov.-déc. 1998a, 54-55). À la fin janvier 1999, 17 activistes du SSP avaient déjà été tués dans de [traduction] « faux » affrontements avec la police, selon Cheikh Hakim Ali, président du SSP au Pendjab[24]24 (AFP 31 janv. 1999). En décembre 1998, un tribunal antiterroriste spécial à Multan (Pendjab) a condamné à mort 14 activistes chiites et sunnites trouvés coupables d'avoir participé à des attaques lancées en 1996 et en 1997 contre un centre culturel iranien et la mosquée Al-Khair à Multan (JIR mars 1999, 6; The Herald janv. 1999, 102; AFP 29 janv. 1999). Il s'agit, selon une source d'information, du plus grand nombre de personnes condamnées simultanément pour leur rôle dans des crimes terroristes (JIR mars 1999, 6).
La nouvelle politique ne ferait pas l'unanimité chez les cadres policiers : plusieurs cadres supérieurs de la police auraient averti que la pratique de tuer des terroristes sectaires dans de faux affrontements ne fera [traduction] « [qu']empirer la situation » (The Herald janv. 1999, 102; ibid. nov.-déc. 1998a, 54-55). Un cadre supérieur a fait remarquer qu'en tuant des suspects, la police perd la possibilité de leur soutirer des renseignements sur leurs réseaux (ibid., 55). Il a également affirmé que les activistes individuels sont soutenus par des organisations possédant de nombreux hommes armés hautement motivés et très bien formés qui sont capables de causer de sérieux ennuis à la police et au gouvernement (ibid.). Un autre cadre supérieur est d'avis qu'en tuant des suspects dans de faux affrontements, la police fait comprendre aux activistes qu'ils seraient tués [traduction] « même s'ils se livrent », ce qui n'a pour effet que de les rendre encore plus désespérés (ibid. janv. 1999, 102). Un troisième cadre a déclaré que la pratique de tuer des suspects dans de faux affrontements à intensifié la détérioration du professionnalisme chez les policiers : [traduction] « les cadres policiers savent qu'ils n'ont pas besoin de préparer une affaire en vue de la porter devant les tribunaux [parce qu'ils] peuvent facilement recourir à des exécutions extrajudiciaires. Par conséquent, les cadres policiers ont commencé à négliger les procédures appropriées d'enquête et de poursuite judiciaire » (ibid. mai 1999c, 52). The Herald fait remarquer que depuis quelques années, les partis sectaires durs tenaient les activistes à distance, mais que les partis ont recommencé à faire bon accueil à ces derniers depuis que la police s'est mise à tuer des suspects dans de faux affrontements (ibid. janv. 1999, 102). En outre, les policiers chargés de la lutte contre les terroristes sectaires se trouvent maintenant sous la menace constante de représailles (ibid. nov.-déc. 1998a, 55).
Autre source de difficultés : le gouvernement n'a toujours pas corrigé les politiques qui étaient à l'origine de la montée en flèche des conflits violents entre les sectes (ibid. nov.-déc. 1998b, 52). Ainsi, il continue de parrainer des organisations du jihad en Afghanistan et au Cachemire (ibid.; JIR mars 1996, 6) et, selon plusieurs sources, n'a rien fait pour améliorer les piètres procédures d'enquête et de poursuite judiciaire qui ont eu pour effet de permettre à des criminels de se faire acquitter (The Herald avr. 1999, 32; Country Reports 1998 1999, section 1e; The Friday Times 21-27 nov. 1996, 6). Selon un article de presse, en août et en septembre 1998 le secrétariat du premier ministre a reçu trois rapports rédigés par des services de renseignements - un du ministère de l'Intérieur, un du ministère des Affaires étrangères, et un rédigé conjointement par divers services de renseignements - concernant les activités et les ressources financières des organisations sectaires activistes qui formaient des volontaires du jihad (Dawn 5 mars 1999). Ces rapports, l'aboutissement d'une opération de collecte de renseignements qui avait duré un an, n'auraient suscité aucune action ni prise de décision sauf l'ordre de [traduction] « continuer le processus de confirmation » (ibid.).
Après avoir fait savoir qu'il modifierait la loi sur la répression du terrorisme de manière à la rendre conforme à la constitution (HRW 1998; Country Reports 1998 1999, section 1c), le gouvernement a mis sur pied, en décembre 1998, des tribunaux militaires appelés Military Trial Courts (MTC) qui eux aussi, en février 1999, ont été déclarés illégaux par la cour suprême (HRW 18 févr. 1999; AP 28 avr. 1999; AFP 29 avr. 1999). Ensuite, le 28 avril 1999, le gouvernement a eu recours à une ordonnance présidentielle pour créer de nouveaux tribunaux antiterroristes (The Daily Star 29 avr. 1999; Dawn 29 avr. 1999). Cette ordonnance modifiée de 1999 sur la répression du terrorisme (Anti-Terrorism (Amendment) Ordinance 1999) conservait de nombreuses dispositions de la loi sur la répression du terrorisme (ATA), tout en ajoutant une nouvelle infraction appelée [traduction] « création de perturbations civiles » (creation of civil commotion) (AP 28 avr. 1999; Dawn 29 avr. 1999; ibid. 1er mai 1999). Cette nouvelle disposition s'est attirée de nombreuses critiques de la part des partis de l'opposition, des groupes de défense des droits de la personne et de la presse pakistanaise qui croient qu'elle met en danger les droits constitutionnels au rassemblement pacifique et à l'expression de la dissidence politique (AFP 1er mai 1999; Dawn 1er mai 1999). Les nouveaux tribunaux ont commencé leur travail le 12 mai 1999 à Karachi et ont imposé la peine capitale pour la première fois trois jours plus tard (DPA 12 mai 1999; AFP 15 mai 1999); on s'attendait à ce que d'autres tribunaux de ce genre commencent leur travail sous peu dans d'autres villes du Sindh et du Pendjab (DPA 12 mai 1999; AFP 15 mai 1999).
En avril 1999, le premier ministre Sharif a eu une rencontre avec des dirigeants du TJP et du SSP à Islamabad (Dawn 1er avr. 1999; The Herald mai 1999a, 48) dans le but de rapprocher les deux groupes et de trouver un moyen d'arrêter la violence dans les conflits entre les sectes (Dawn 1er avr. 1999; The Herald mai 1999a, 48). Après cette rencontre, le premier ministre a annoncé la création d'un [traduction] « comité puissant d'oulémas et d'érudits religieux » chargé de formuler des recommandations concernant la suppression de la violence dans les conflits entre les sectes au Pakistan (Dawn 4 avr. 1999a; The Herald mai 1999a, 48). Le comité, composé de 10 membres, a proposé plusieurs recommandations, mais une semaine plus tard le TJP s'en est retiré parce que, selon lui, le président du comité, Israr Ahmed, était une personne controversée qui ne respectait pas les décisions du comité (ibid., 48-49). Par la suite, Ahmed lui-même a démissionné, ce qui a interrompu le travail du comité dont l'avenir est devenu incertain (ibid.).
À PROPOS DE CERTAINES SOURCES
Abbas, Azhar
Azhar Abbas est un des reporters principaux du mensuel The Herald de Karachi. M. Abbas couvre l'actualité politique.
Choudary, Maqsood
Maqsood Choudary, originaire de Sialkot (Pendjab), est professeur de politicologie au Mount Mercy College de Cedar Rapids (Iowa). Spécialiste des affaires du Moyen-Orient, le professeur Choudary s'intéresse particulièrement aux politiques en matière de modernisation et de développement, à la formation d'États, aux rapports entre l'État et la société et aux mouvements sociaux et politiques en Syrie et au Pakistan.
The Friday Times
L'hebdomadaire indépendant de langue anglaise The Friday Times est un magazine d'actualités de Lahore. Son propriétaire Najam Sethi a récemment été arrêté dans le cadre des mesures de répression prises à l'échelle du pays contre les journalistes qui critiquaient le gouvernement (AP 23 juin 1999; IPS 4 juin 1999).
The Herald
Le mensuel The Herald de Karachi est parmi les magazines d'actualités de langue anglaise les plus lus, respectés et influents du Pakistan. Il offre une couverture opportune et détaillée des affaires politiques nationales et provinciales ainsi que des autres événements ayant des répercussions à l'échelle du pays. Affilié au groupe de presse Dawn, The Herald a des bureaux à Islamabad, à Lahore, à Peshawar, à Multan, à Quetta et à Hyderabad. Le magazine est toutefois une publication indépendante. L'adresse de son site Web : (http://www.dawn.com/herald/).
Human Rights Commission of Pakistan (HRCP)
L'organisation non gouvernementale Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) (commission des droits de la personne du Pakistan) publie un rapport annuel qui traite de divers aspects de la situation des droits de la personne au Pakistan, et notamment de l'administration de la justice, de l'ordre public, des activités des organismes chargés d'appliquer les lois, des conditions carcérales, du traitement des prisonniers, de la liberté de la presse, des droits des femmes, des droits des enfants et des droits des travailleurs. Outre la surveillance de la situation des droits de la personne, la HRCP prend des mesures pour sensibiliser le public aux enjeux et intervient dans le domaine juridique. Depuis le printemps de 1999, la HRCP a un site Web à l'adresse (http://www.hrcp.8m.com/).
RÉFÉRENCES
Abbas, Azhar (reporter principal du mensuel The Herald de Karachi). 3 juin 1999. Correspondance.
Abbas, Azhar. 26 mai 1999. Correspondance.
The Age. 27 mars 1995. « Killers of Karachi Find New Excuse to Practise Their Trade ». (CISNet)
Agence France Presse (AFP). 15 mai 1999. « Karachi Special Court Hands Death Penalty to Triple-Murder Accused ». (NEXIS)
Agence France Presse (AFP). 1er mai 1999. « Pakistan Government Faces Flak over New Anti-Terrorism Law ». (NEXIS)
Agence France Presse (AFP). 29 avril 1999. « New Anti-Terrorism Courts Set Up in Karachi ». (NEXIS)
Agence France Presse (AFP). 6 avril 1999a. « Security Tightened as Police Kill Pakistan's Most Wanted Man ». (NEXIS)
Agence France Presse (AFP). 6 avril 1999b. « Punjab Governor Denies Death of Pakistan's Most Wanted Criminal ». (NEXIS)
Agence France Presse (AFP). 12 février 1999. « Pakistani Shia Politician Asks Government to Allow Private Militia ». (NEXIS)
Agence France Presse (AFP). 31 janvier 1999. « Pakistan Extremist Group Blames Police for Killing of Its Activists ». (NEXIS)
Agence France Presse (AFP). 29 janvier 1999. « Six Including Five Police Shot Dead by "Terrorists" in Pakistan ». (NEXIS)
Agence France Presse (AFP). 22 février 1998. « Bomb Rocks Karachi Mosque as Police Probe Iranian Killings ». (NEXIS)
Agence France Presse (AFP). 30 décembre 1996. « Pakistani Police Arrest Top Shiite Moslem Militant ». (NEXIS)
Ahmed, Munir D. 1987. « The Shi'is of Pakistan ». Shi'ism, Resistance and Revolution. Dirigé par Martin Kramer. Boulder, Col. : Westview Press.
Amnesty International (AI). 1998. Amnesty International Report 1998: Pakistan. (http://www.amnesty.org) [Date de consultation : 4 mars 1999]
Asiaweek [Hong Kong]. 8 janvier 1999. Anthony Davis. « Riding the Taliban Tiger: The Price Pakistan Pays for Creating a Monster ». (http://www.pathfinder.com) [Date de consultation : 1er avr. 1999]
The Associated Press (AP). 23 juin 1999. « Pakistan Refuses to Let Amnesty International Award Winner Leave ». (AP Worldstream/NEXIS)
The Associated Press (AP). 28 avril 1999. « Pakistan Orders Anti-Terror Courts ». (NEXIS)
The Associated Press (AP). 4 avril 1999. Khalid Tanveer. « Pakistani Police Arrest 75 Members of Militant Muslim Group ». (AP Worldstream/NEXIS)
The Associated Press (AP). 12 octobre 1998. Kathy Gannon. « Strict Religious Schools Maintain Hold on Pakistan ». (Nando Times News) (http://www.techserver.com) [Date de consultation : 1er avr. 1999]
Choudary, Maqsood (professeur de politicologie, Mt. Mercy College, Cedar Rapids, Iowa). 31 mai 1999. Correspondance.
Choudary, Maqsood. 29 mai 1999. Correspondance.
Contemporary Religions: A World Guide. 1992. Dirigé par Ian Harris et al. The High, Harlow, Essex : Longman Group UK.
Country Reports on Human Rights Practices for 1998. 1999. Département d'État des États-Unis. Washington, DC. (http://www.state.gov) [Date de consultation : 4 mars 1999]
Current History [Philadelphie]. Février 1999. Vol. 98, no 625. Barnett R. Rubin. « Afghanistan under the Taliban ».
Current History [Philadelphie]. Décembre 1997. Vol. 96, no 614. Samina Ahmed. « Pakistan at Fifty: A Tenuous Democracy ».
Current History [Philadelphie]. Avril 1996. Vol. 95, no 600. Ahmed Rashid. « Pakistan: Trouble Ahead, Trouble Behind ».
The Daily Star [Dhaka]. 28 mai 1999. « Militants Step Up Fight Against Indian Forces in Kashmir ». (http://www.dailystarnews.com) [Date de consultation : 28 mai 1999]
The Daily Star [Dhaka]. 29 avril 1999. « Pak Government Orders Establishment of Anti-Terrorist Courts ». (http://www.dailystarnews.com) [Date de consultation : 29 avr. 1999]
The Daily Star [Dhaka]. 7 avril 1999. « Sunni Leader Shot Dead in Pakistan: Supporters Threaten Death to Ministers ». (http://www.dailystarnews.com) [Date de consultation : 12 avr. 1999]
The Daily Telegraph [Londres]. 8 mars 1995. Ahmed Rashid. « Pakistani Muslim Violence Spreads ». (NEXIS)
Dawn [Karachi]. 1er mai 1999. « New Anti-Terrorism Law Sparks Off Row ». (http://www.dawn.com) [Date de consultation : 3 mai 1999]
Dawn [Karachi]. 29 avril 1999. « Ordinance Finally Promulgated: ATA Courts to Try Cases of "Civil Commotion" ». (http://www.dawn.com) [Date de consultation : 29 avr. 1999]
Dawn [Karachi]. 6 avril 1999a. « Dir Officials Re-arrest TNSM Chief ». (http://www.dawn.com) [Date de consultation : 6 avr. 1999]
Dawn [Karachi]. 6 avril 1999b. Sajjad Abbas Niazi. « Riaz Basra Killed in Encounter, Claim Police ». (http://www.dawn.com) [Date de consultation : 6 avr. 1999]
Dawn [Karachi]. 5 avril 1999. « Supreme Court Urged to Take Notice of Extra-judicial Killings ». (http://www.dawn.com) [Date de consultation : 6 avr. 1999]
Dawn [Karachi]. 4 avril 1999. « Body Set Up: Ulema Asked to Help End Terrorism ». (http://www.dawn.com) [Date de consultation : 6 avr. 1999]
Dawn [Karachi]. 3 avril 1999. « Police Suspect Muttahida Behind ST Man's Killing ». (http://www.dawn.com) [Date de consultation : 6 avr. 1999]
Dawn [Karachi]. 1er avril 1999. « Nawaz Chairs TJP, SSP Leaders' Joint Meeting Today ». (http://www.dawn.com) [Date de consultation : 1er avr. 1999]
Dawn [Karachi]. 5 mars 1999. « No Success to Check Activities of Militant Organizations ». (http://www.dawn.com) [Date de consultation : 5 mars 1999]
Dawn [Karachi]. 3 février 1999. Azmat Abbas. « Lahore: Lashkar-i-Jhangvi "Involved" in Multan Killings ». (http://www.dawn.com) [Date de consultation : 3 févr. 1999]
Dawn [Karachi]. 26 décembre 1998. Azmat Abbas. « Punjab Sectarian Violence Toll Comes Down in 1998 ». (http://www.dawn.com) [Date de consultation : 4 janv. 1999]
Dawn [Karachi]. 16 octobre 1998. Shadaba Islam. « Report Dubs Pakistan "Narco-State" ». (http://www.dawn.com) [Date de consultation : 16 oct. 1998]
Deutsche Presse-Agentur (DPA). 12 mai 1999. Cycle BC. « Anti-Terrorist Courts Start Functioning in Southern Pakistan ». (NEXIS)
Deutsche Presse-Agentur (DPA). 21 février 1998. Cycle BC. « Two Iranian Nationals Shot Dead in Pakistan Attack ». (NEXIS)
Deutsche Presse-Agentur (DPA). 12 janvier 1998. Cycle BC. « Riots Mark Funeral of Victims of Sectarian Violence in Pakistan ». (NEXIS)
Deutsche Presse-Agentur (DPA). 22 août 1997. Cycle BC. « Pak Court Orders Shifting of Moslem Leaders to Regular Jails ». (NEXIS)
The Economist [New York]. 28 janvier-3 février 1995. « Pakistan: Holy War ».
États-Unis, Comité des relations étrangères du sénat (Senate Committee on Foreign Relations). 8 octobre 1998. « Testimony on the Situation in Afghanistan ». (Open Society Institution) (http://soros.org/cen_eurasia/br2.html) [Date de consultation : 31 mars 1999]
Extremist Groups: An International Compilation of Terrorist Organizations, Violent Political Groups and Issue-Oriented Militant Movements. 1996. Compilé et analysé par Jeffrey A. Builta. Dirigé par John Murray et Richard H. Ward. Chicago : Office of International Criminal Justice.
Far Eastern Economic Review (FEER) [Hong Kong]. 9 mars 1995a. Ahmed Rashid. Vol. 158, no 10. « The Great Divide: Shias and Sunnis Battle It Out in Pakistan ».
Far Eastern Economic Review (FEER) [Hong Kong]. 9 mars 1995b. Ahmed Rashid. Vol. 158, no 10. « Schools for Soldiers: Islamic Schools Mix Religion and Politics ».
The Friday Times [Lahore]. 14-20 août 1998. « The Taliban are Coming ». (Eurasianews) (http://eurasianews.com) [Date de consultation : 1er avr. 1999]
The Friday Times [Lahore]. 21-27 novembre 1996. Adnan Adil. « Sectarian Violence Threat in Bahawalnagar and Bahawalpur ».
The Globe and Mail [Toronto]. 20 août 1998. John Stackhouse. « Will Karachi Be the Next Kabul? ».
The Herald [Karachi]. Mai 1999a. Vol. 30, no 5. Zaigham Khan. « Peace at Raiwind ».
The Herald [Karachi]. Mai 1999b. Vol. 30, no 5. Azmat Abbas. « Last Encounter? ».
The Herald [Karachi]. Mai 1999c. Vol. 30, no 5. Ali Ahmed. « The Myth of Good Governance ».
The Herald [Karachi]. Avril 1999. Vol. 30, no 4. Idrees Bakhtiar. « Your Men or Mine? ».
The Herald [Karachi]. Février 1999a. Vol. 30, no 2. Haroon Rashid. « Faith, Violence and Videotape ».
The Herald [Karachi]. Février 1999b. Vol. 30, no 2. Rizwan Qureshi. « The Second Coming ».
The Herald [Karachi]. Janvier 1999. Vol. 30, no 1. Azmat Abbas. « Law and Disorder ».
The Herald [Karachi]. Novembre-décembre 1998a. Vol. 29, nos 11-12. Azmat Abbas. « Terror Tactics ».
The Herald [Karachi]. Novembre-décembre 1998b. Vol. 29, nos 11-12. Zaigham Khan. « Fight to the Finish ».
The Herald [Karachi]. Septembre 1998a. Vol. 29, no 9. Zaigham Khan. « Playing with Fire ».
The Herald [Karachi]. Septembre 1998b. Vol. 29, no 9. Zaigham Khan. « Allah's Armies ».
The Herald [Karachi]. Septembre 1998c. Vol. 29, no 9. Zaigham Khan. « Divided They Stand ».
The Herald [Karachi]. Septembre 1998d. Vol. 29, no 9. Azmat Abbas. « New Breed ».
The Herald [Karachi]. Septembre 1998e. Vol. 29, no 9. Rizwan Qureshi. « The Pakistani Connection ».
The Herald [Karachi]. Avril 1998. Vol. 29, no 4. Zaffar Abbas. « The Enemy Within ».
The Herald [Karachi]. Février 1998a. Vol. 29, no 2. Zaigham Khan. « The Tragedy of Mominpura ».
The Herald [Karachi]. Février 1998b. Vol. 29, no 2. Aamer Ahmed Khan. « The Doctrine of Injured Religious Sentiment ».
The Herald [Karachi]. Janvier 1998. Vol. 29, no 1. Zaigham Khan. « Allah's Army ».
The Herald [Karachi]. Décembre 1997. Vol. 28, no 12. Owais Tohid. « The Jehad at Home ».
The Herald [Karachi]. Octobre 1997. Vol. 28, no 10. Zaigham Khan. « Raising the Stakes ».
The Herald [Karachi]. Août 1997. Vol. 28, no 8. Aamer Ahmed Khan. « Moving Targets ».
The Herald [Karachi]. Juin 1997. Vol. 28, no 6. Zaigham Khan. « Blood on the Streets ».
The Herald [Karachi]. Décembre 1996. Vol. 27, no 12. Zaigham Khan. « Crime and Punishment ».
The Herald [Karachi]. Octobre 1996. Vol. 27, no 10. Zaigham Khan. « The Fanatics Strike Back ».
The Herald [Karachi]. Septembre 1996. Vol. 27, no 9. Aamer Ahmed Khan. « Playing with Fire ».
The Herald [Karachi]. Juin 1994a. Vol. 25, no 6. Aamer Ahmed Khan. « Faction Replay ».
The Herald [Karachi]. Juin 1994b. Vol. 25, no 6. Aamer Ahmed Khan. « Blind Faith ».
The Herald [Karachi]. Juin 1994c. Vol. 25, no 6. Aamer Ahmed Khan. « The Rise of Sectarian Mafias ».
Human Rights Commission of Pakistan (HRCP). 1999. State of Human Rights in 1998. (http://hrcp.8m.com/) [Date de consultation : 30 mars 1999]
Human Rights Commission of Pakistan (HRCP). 1998. State of Human Rights in 1997. Lahore : HRCP.
Human Rights Commission of Pakistan (HRCP). 1997. State of Human Rights in 1996. Lahore : HRCP.
Human Rights Watch (HRW). 18 février 1999. « Shut-Down of Military Courts in Pakistan Hailed, but Transfer of Cases to Anti-Terrorism Courts Sharply Condemned ». ([email protected])
Human Rights Watch (HRW). Décembre 1998. Human Rights Watch World Report 1999. (http://www.hrw.org) [Date de consultation : 16 déc. 1998]
India Abroad [Toronto]. 23 septembre 1994. Aabha Dixit. « Sectarian Crisis Growing in Pakistan ». (The Ethnic NewsWatch/NEXIS)
India Today [New Delhi]. 14 septembre 1998. Zahid Hussain et Manoj Joshi. « Pakistan: In a Holy Mess ». (http://www.india-today.com) [Date de consultation : 31 mars 1999]
Indian Express [Bombay]. 31 décembre 1998. Ashwani Talwar. « Pak Politicians at Ultras' Meet ». (http://www.expressindia.com) [Date de consultation : 1er avr. 1999]
Inter Press Service (IPS). 4 juin 1999. « Pakistan: Fight for Free Press not over with Editor's Release ». (NEXIS)
Inter Press Service (IPS). 3 septembre 1998. Dipankar De Sarkar. « Rights-Afghanistan: Amnesty Says Taliban "Massacred Thousands" ». (NEXIS)
International Affairs [Londres]. 1997. Vol. 73, no 2. John Bray. « Pakistan at 50: A State in Decline? ».
Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA), New Delhi. Décembre 1998. S. Pattanaik. « Islam and the Ideology of Pakistan ». (http://www.idsa-india.org) [Date de consultation : 31 mars 1999]
Islam and Islamic Groups: A Worldwide Reference Guide. 1992. Dirigé par Farzana Shaikh. The High, Harlow, Essex : Longman Group UK.
Jane's Intelligence Review (JIR) [Surrey, R.-U.]. Mars 1999. Vol. 11, no 3. Anthony Davis. « Action Taken over Punjabi Violence ». (NEXIS)
Jane's Intelligence Review (JIR) [Surrey, R.-U.]. Janvier 1999. Vol. 11, no 1. Anthony Davis. « Pakistan: State of Unrest ».
Jane's Intelligence Review (JIR) [Surrey, R.-U.]. Octobre 1997. Vol. 9, no 10. Roger Howard. « Wrath of Islam: The HUA Analysed ».
Jilani, Hina. 1998. Human Rights and Democratic Development in Pakistan. Lahore : Human Rights Commission of Pakistan.
Modern Asian Studies [Cambridge, UK]. Juillet 1998. Vol. 32, no 3. Muhammad Qasim Zaman. « Sectarianism in Pakistan: The Radicalization of Shi'i and Sunni Identities ».
Muslimedia [Londres]. 16-31 mars 1998. Zafar Bangash. « Pakistan Caught in False Debate Between Secularism and Sectarianism ». (http://www.muslimedia.com) [Date de consultation : 18 mai 1999]
The News [Karachi]. 22 février 1997. « 75 Killed in Last Nine Months ». (http://www.best.com) [Date de consultation : 2 mars 1999]
The News International [Karachi]. 4 mars 1999. Amir Mir. « Men Behind Raiwind Blast Linked to Harkatul Ansar: Report ». (http://www.jang-group.com) [Date de consultation : 1er avr. 1999]
The News International [Karachi]. 17 novembre 1998. « Top Lashkar-e-Jhangvi Activist, 12 Others Arrested ». (http://www.jang-group.com) [Date de consultation : 17 nov. 1998]
Pakistan Press International (PPI). 30 mars 1998. « Three Killed in Multan ». (http://www.pakistan-news.com) [Date de consultation : 31 mars 1999]
Patterns of Global Terrorism: 1998. 1999. « Pakistan ». Département d'État des États-Unis. (http://www.state.gov/) [Date de consultation : 31 mai 1999]
Patterns of Global Terrorism: 1997. 1998. « The Harakat ul-Ansar (HUA) ». Département d'État des États-Unis. (http://web.nps.navy.mil/~library/tgp/hua.htm) [Date de consultation : 1er avr. 1999]
Political Parties of Asia and the Pacific. 1985. Vol. 1. Dirigé par Haruhiro Fukui et al. Westport, Conn : Greenwood Press.
Political Parties of the World. 1988. 3rd edition. Dirigé par Alan J. Day. Chicago : St. James Press.
Radio Pakistan [Islamabad, en anglais]. 7 avril 1999. « Pakistan: Magistrate Issues Press Note on Killing of "Terrorists" ». (BBC Worldwide Monitoring 7 avr. 1999/NEXIS)
Religion in Politics: A World Guide. 1989. Dirigé par Stuart Mews. Chicago : St. James Press.
Reuter. 4 mai 1997. Cycle BC. Alistair Lyon. « Sunni-Shi'ite Killings Raise Tension in Pakistan ». (NEXIS)
Reuter. 7 mars 1995. Cycle BC. Aurang Zeb. « Gunmen Kill Pakistan Militant Shi'ite Leader ». (NEXIS)
St. Vincent, David. 1992. Iran: A Travel Survival Kit. Hawthorn, Victoria, Australie : Lonely Planet.
Time [New York]. 28 septembre 1998. Tim McGirk, Ghulam Hasnain and Syed Talat Hussain. « The Sword of Islam: With Pakistan Isolated and Near Economic Collapse, Its Leader Plays the Religion Card ». (NEXIS)
US News & World Report [Washington, DC]. 17 février 1997. Jennifer Griffin. « A Dangerous Mix of Guns, Cash, Radical Islam-and Apathy ».
The Washington Post. 28 novembre 1998. Final edition. Kamran Khan. « Afghan Revenge Killings Spread to Pakistan ». (NEXIS)
The Xinhua News Agency. 6 avril 1999. « Punjab Governor Denies Report of Killing of Top Terrorist ». (NEXIS)
[1]1. Des renseignements sur certains aspects des rapports violents entre les sectes sunnites et les sectes chiites sont égalements fournis dans les réponses aux demandes d'information PAK31812.E du 28 avril 1999, PAK31672.E du 21 avril 1999, PAK31582.E du 15 avril 1999, PAK31581.E du 13 avril 1999, PAK31579.E du 13 avril 1999, et PAK29941.E du 4 septembre 1998, consultables aux centres de documentation régionaux de la CISR, dans la base de données REFINFO et sur l'Internet au site Web de la CISR à l'adresse (http://www.cisr.gc.ca).
[2]2. Selon le professeur Maqsood Choudary, la principale division au sein des sunnites pakistanais est celle entre les deobandis et barelvis (29 mai 1999). Les deux courants dérivent de mouvements indo-musulmans réformateurs du XIXe siècle nés dans des séminaires religieux situés à Deoband et à Bareilly. Les deobandis suivent la ligne puriste du groupe wahabiste Ahl- Hadith, ligne qui a vu le jour en Arabie saoudite, alors que dans la tradition des barelvis, on remarque une certaine influence du soufisme et de l'hindouisme (ibid.; ibid. 31 mai 1999).
[3]3. Aucune des sources d'information consultées n'ayant fait de distinction entre les trois courants chiites, ils sont considérés comme un seul groupe dans le présent exposé.
[4]4. Outre les activistes pakistanais, le gouvernement Zia a permis à plus de 25 000 activistes de 30 pays de recevoir de la formation militaire au Pakistan en vue de participer aux combats en Afghanistan (Current History avr. 1996, 161).
[5]5. Selon la commission des droits de la personne du Pakistan (Human Rights Commission of Pakistan - HRCP), si la plupart des madrassas suivent la fiqh (jurisprudence islamique) deobandie (48 p. 100) ou barelvie (44 p. 100), il y en a également qui suivent la tradition des groupes Ahl-e Hadith (8 p. 100) et Ahl-e Tashih (moins d'un pour cent) (1997, 88-89; ibid. 1998, 222).
[6]6. Le nombre estimé de madrassas enregistrées au Pakistan varie entre 4 000 et 8 000 selon les données d'une source gouvernementale (AP 12 oct. 1998; HRCP 1998, 222; The Herald déc. 1997, 64); une source d'information évalue le nombre d'écoles religieuses enregistrées à 25 000 (ibid.). En 1975, 100 000 garçons et jeunes gens étudiaient dans les madrassas; en 1998, leur nombre était évalué entre 540 000 et 570 000 (JIR janv. 1999, 34; AP 12 oct. 1998). Le Pendjab compterait à lui seul 220 000 élèves (HRCP 1998, 222). The Herald rapporte que Karachi comprend au moins 29 écoles religieuses incluant chacune 2 000 élèves; la deuxième madrassa en importance au Pakistan, la Jamiat-ul-Uloom-ul-Islamia à Binori, peut accueillir 8 000 élèves (déc. 1997, 64-65).
[7]7. Selon une source d'information qui remonte à 1994, la quasi-totalité des violences sectaires du Pakistan se produisent dans quatre zones : Karachi et Hyderabad dans la région urbanisée du Sindh, le district de Parachinar dans la Province frontière du nord-ouest (NWFP), les régions de Gilgit et de Baltistan dans le nord, et la zone Multan-Jhang-Mianwali-Faisalabad au Pendjab (India Abroad 23 sept. 1994). Également en 1994 The Herald a signalé que les cinq districts de Sialkot, de Jhang, de Gujranwala, de Faisalabad et de Sargodha constituaient la zone du sectarisme au Pendjab et, du fait, une [traduction] « mine d'or » pour les groupes extrémistes de toute espèce (juin 1994b, 33; ibid. juin 1994c, 28). Des sources plus récentes signalent une escalade des conflits violents entre les sectes dans les districts de Bahawalnagar, de Bahawalpur, de Vehari et de Khanewal au Punjab au cours des dernières années (The Friday Times 21-27 nov. 1996, 7), et l'on craint que la violence ne s'étende également dans la province du Sindh (Abbas 26 mai 1999). Selon certaines sources d'information, il se peut que les conflits violents entre les sectes aient commencé dans le district de Jhang au Pendjab, car si la population est sunnite dans son écrasante majorité, le pouvoir dans la région appartient à de riches propriétaires fonciers chiites (Modern Asian Studies juill. 1998, 700-701; Abbas 26 mai 1999).
[8]8. Une source d'information qualifie l'ISO d'aile étudiante activiste du TJP (Reuter 7 mars 1995) et deux autres la qualifie de faction scissionniste activiste du TJP (The Daily Telegraph 8 mars 1995; The Herald juin 1997, 56), toutefois, selon les dirigeants de l'ISO, l'organisation existe depuis 1972, a des sources de financement indépendantes et n'a adhéré au TJP que plusieurs années après sa création (ibid. sept. 1998c, 48b-48c). The Herald déclare que l'ISO constituait autrefois la base du TJP (ibid., 48b).
[9]9. La ville de Qom, centre chiite important où l'on trouve de nombreux séminaires, est considérée comme une ville sainte (St. Vincent 1992, 139-140).
[10]10. Dans un entretien avec The Herald vers la fin de 1996, Naqvi affirmait avoir 14 000 [traduction] « unités » au Pakistan (oct. 1996a, 57). Modern Asian Studies signale que des organisations chiites ont bel et bien des sections au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord, mais l'ouvrage ne mentionne pas le SMP en particulier (juill. 1998, 704 n51).
[11]11. Syed Jabbar Hussein, nouveau chef du groupe SMP, accuse Naqvi d'être le principal responsable de la criminalisation de l'organisation (The Herald déc. 1996, 56). Soupçonné d'avoir participé à des dizaines de meurtres et d'attaques terroristes, Naqvi, dont on avait mis à prix la tête en offrant une récompense de 1 million de roupies (28 400 $CAN), a été arrêté le 30 décembre 1996 à Lahore (AFP 30 déc. 1996). Aux dernières nouvelles, la cause de Naqvi était toujours devant les tribunaux vers la fin août 1997 (DPA 22 août 1998). Azhar Abbas a déclaré au début juin 1999 qu'à ce qu'il sache, Naqvi était toujours en détention (3 juin 1999).
[12]12. Abbas a déclaré que l'un or l'autre des organismes de sécurité se sont infiltrés, à un niveau ou à un autre, dans les groupes sectaires les plus violents (26 mai 1999). Il a précisé que l'infiltration par un organisme de sécurité n'empêche pas un groupe de continuer de fonctionner (ibid.).
[13]13. La faction de la JUI menée par Rahman, appelée parfois la JUI(F), a appuyé le gouvernement PPP de Benazir Bhutto, et Rahman a occupé le poste de président de la commission des affaires étrangères sous ce régime (Current History févr. 1999, 85; India Today 14 sept. 1998). Une autre faction, appelée JUI(S) et menée par Maulana Sami-ul Haq, dirige deux grandes madrassas - la Dar ul-Uloom Haqania d'Akora Khattak à Nowshehra (Province frontière du nord-ouest), et la Jamia Uloom-ul-Islamiya de Karachi (Current History févr. 1999, 85; Choudary 29 mai 1999). Selon le professeur Choudary, la Dar ul-Uloom Haqania est une [traduction] « pépinière » connue de talibans (ibid.). Azhar Abbas a affirmé que c'est avec les talibans que la JUI entretient des liens directs, et non avec les groupes sectaires violents du Pakistan (26 mai 1999). Selon Abbas, tout autre lien lien serait indirect, et revêterait la forme d'appui moral accordé aux organisations qui s'inscrivent dans le même courant de l'islam.
[14]14. Le SSP s'appelait à l'origine Anjuman-e Sipah-e Sihaba Pakistan (ASSP), nom qui veut dire société pour les soldats des compagnons du prophète (JIR janv. 1999, 35).
[15]15. Selon The Herald, la scission s'est produite en 1989, soit un an avant l'assassinat de Jhangvi (juin 1994a, 35).
[16]16. Une source d'information fait remarquer que malgré son orientation deobandie, le groupe SSP a parfois collaboré avec les barelvis dans certaines affaires où ils faisaient front commun contre les chiites (The Herald juin 1994a, 35).
[17]17. Selon The Herald, le SSP a été la première organisation sectaire à publier et à diffuser, à une si grande échelle, de la documentation sectaire qu'elle considérait comme injurieuse (ibid. juin 1994c, 31).
[18]18. Azhar Abbas a déclaré qu'on connaît peu de choses sur les activités menées à l'étranger par les organisations sectaires pakistanaises (26 mai 1999). Il se peut, selon lui, que la collecte de fonds et la prédication soient les activités-clés de ces organisations à l'étranger, et il a ajouté que celles-ci, selon toute probabilité, menaient leurs activités dans des mosquées plutôt que dans des bureaux. Il croyait que les sections étrangères étaient beaucoup mieux enracinées au Moyen-Orient - où la plupart des organisations obtenaient du soutien moral et financier - qu'en Europe ou en Amérique du Nord (ibid.).
[19]19. Pour des renseignements sur le MQM et la situation à Karachi, voir les documents Le Pakistan : le Mouvement Qaumi Mohajir (MQM) à Karachi, janvier 1995-avril 1996 (nov. 1996) et Pakistan : le point sur le Mouvement Qaumi Mohajir (MQM) à Karachi (juin 1997), publiés par la Direction des recherches dans la série « Questions et réponses » et consultables aux centres de documentation régionaux de la CISR, dans la base données REFQUEST de la CISR, et au site Web de la CISR à l'adresse (www.cisr.gc.ca).
[20]20. Par exemple, en août 1997, après une vague de meurtres liés aux conflits entre les sectes, le gouvernement du Pendjab a interdit aux motocyclistes partout au Pendjab de transporter des passagers, et ce dans le but de mettre le holà aux attaques éclair d'hommes armés de grenades et d'automatiques. Selon The Herald, cette mesure était absolument inefficace : en décembre 1998, le gouvernement a avoué à l'assemblée législative du Pendjab que parmi les 1 900 personnes arrêtées à Lahore pour avoir violé l'interdiction, il n'y avait pas un seul terroriste ou criminel recherché (janv. 1999, 101).
[21]21. Une source d'information a déclaré en 1994 que depuis l'entrée dans l'arène politique du groupe SSP, [traduction] « il y au moins trois districts du Bas Pendjab où aucun parti traditionnel ne peut remporter la victoire sans l'appui [du SSP] » (India Abroad 23 sept 1994).
[22]22. Selon The Herald, il est inutile de négocier avec ces groupes car ils n'ont aucun programme politique dont la réalisation puisse être avancée par un dialogue. [Traduction] « Leur survie dépend de la continuation de la violence, celle-ci étant leur seule raison d'être » (juin 1997, 54).
[23]23. Le général Babar était chargé de mettre en application la politique du gouvernement prévoyant l'exécution extrajudiciaire de membres du MQM à Karachi en 1995 et en 1996 (The Herald nov.-déc. 1998b, 50). Pour plus d'information sur les méthodes employées dans ces opérations menées à Karachi, voir les documents publiés en novembre 1996 et en juin 1997 dans la série « Questions et réponses » et mentionnés ci-dessus dans la note 18.
[24]24. The Herald cite un policier du Pendjab qui aurait déclaré que [traduction] « le gouvernement du Pendjab, conformément à sa politique en la matière, a tué des centaines de personnes sans procès judiciciaire » (mai 1999c, 52). The Herald estime que depuis 1997, [traduction] « jusqu'à 839 personnes sont mortes [au Pendjab] dans de faux affrontements avec la police (234 en 1997, 453 en 1998 et plus de 150 dans les quatre premiers mois de l'année en cours) »; toutefois, on ne sait pas combien de ces gens étaient des activistes sectaires (ibid.). D'autres sources d'information s'accordent pour dire elles aussi que les exécutions extrajudiciaires au Pendjab sont devenues monnaie courante et qu'elles se produisent presque tous les jours (Abbas 26 mai 1999; Dawn 5 avr. 1999).